Voici venu la fin de cette publication épisodique avec ce dernier chapitre qui marque la fin de quelque chose pour notre héros… ainsi que le début de nouvelles aventures, alors que la mer lui tend les bras. Nous espérons en tout cas que ces premiers chapitres vous auront donné envie de découvrir “Sous le Vent de la liberté“, et plus largement la plume de Christian Léourier.
Bonne lecture !
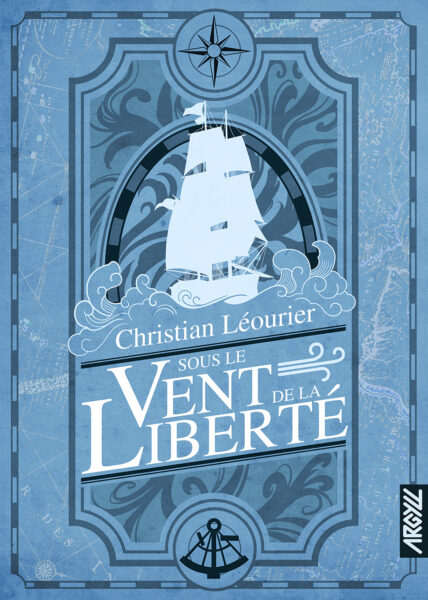
Chapitre 5
À bord de L’Auguste
Le jour pointait à peine. Déjà une activité bouillonnante emplissait le port de sa clameur. Des forçats tiraient sur les cordages d’un palan pour hisser une pièce d’artillerie. Un garde-chiourme dirigeait la manœuvre à grands coups de sifflet tandis que des matelots s’apprêtaient à haler le canon aussitôt qu’il dépasserait le pavois. Plus loin, d’autres bagnards, sous le regard blasé de quelques fusiliers, formaient une chaîne pour embarquer des sacs de vivres. Le torse ployé sous la charge, ils se succédaient sur une longue planche qui reliait le bâtiment au quai. Ils ne redescendaient pas les mains vides : à mesure que la cargaison prenait place dans la cale, ils en évacuaient les sacs de sable qui la lestaient. Je redoutais d’apercevoir un commis de la maison Combray. Encore n’était-ce pas le danger le plus insidieux. N’y avait-il pas, dans la foule, quelques mouches au service du négociant ?
Un bac s’apprêtait à traverser. J’y sautai. Le pilote me réclama quarante deniers. C’était la moitié de ma fortune. Dans mon souci de m’éloigner de la maison Combray, je ne lésinai pas.
Entre le bassin de Ponteniou et la tour Tanguy, des vaisseaux de ligne et des frégates mâtés et gréés attendaient le signal du départ. Je m’arrêtai pour admirer un de ces géants. Son nom, L’Auguste, promettait la gloire à son équipage. Sa muraille noire, immense, dominait le quai telle une forteresse. Les cordages, tendus comme les muscles d’un lutteur, s’élançaient à des hauteurs vertigineuses.
Accoudés au bastingage, des marins m’observaient.
« As-tu fini de bayer ainsi ? Tu vas user la coque, à la reluquer comme ça !
— Je veux souscrire un engagement.
— Vraiment ? C’est donc que tu as le goût du malheur, garçon ! »
Quelques rires fusèrent, bientôt éteints : un officier approchait. Déjà âgé, l’œil clair dans une face hâlée, le front massif, presque proéminent sous sa perruque poudrée, il portait des culottes blanches et une veste rehaussée de parements. Il avait si fière allure que je le pris d’abord pour le capitaine. Sans doute m’avait-il entendu, car il me demanda, du ton le plus affable :
« Comment te nommes-tu, mon garçon ? »
Je ne tenais pas à ce que mon oncle retrouvât ma piste. Aussi, je m’inventai une nouvelle identité :
« Yann Rustan.
— Tu me parais un peu vieux pour faire un mousse. Quel âge as-tu ?
— Dix-sept ans, Monsieur l’officier… Monseigneur… Capitaine…, mentis-je.
— Tu n’as jamais navigué, dirait-on.
— C’est vrai, mais j’apprends vite. »
Il rit. « Eh bien, soit ! Monte et viens t’inscrire sur le rôle. »
Le cœur battant, je m’empressai de répondre à son invitation. L’officier n’était pas le capitaine, mais l’écrivain du bord. Je signai d’une croix le registre où il avait inscrit mon nom, pour ne pas éveiller les soupçons en dévoilant que j’avais de l’instruction. Mon embarquement s’était révélé moins compliqué que je ne le redoutais. En fait, je m’étais exagéré la difficulté : j’apprendrais bientôt qu’au cours des derniers mois les combats contre les Anglais, un peu, le scorbut et la dysenterie, beaucoup, avaient décimé les équipages et qu’on se montrait encore moins exigeant pour les enrôlements qu’à l’ordinaire – ce qui n’était pas peu dire !
« Te voilà marin du roi, mon garçon, dit l’écrivain en fermant le livre. Tu as de la chance, pour tes débuts en mer, d’embarquer sur un vaisseau de premier rang ! »
J’éprouvais de la considération pour ce noble qui ne dédaignait pas d’adresser quelques mots au novice que j’étais. Il m’observait, un œil à demi fermé.
« Yann Rustan, hein ? C’est bien comme cela que tu t’appelles ? »
Je me sentis rougir, soupçonnant qu’il avait éventé ma supercherie. J’en acquis la conviction quand il ajouta : « Peu importe qui tu es vraiment, tu as tes raisons. Assure ton travail, respecte les officiers, sois brave au combat, c’est tout ce qu’on te demande. Mais si tu manques à ton devoir, tu apprendras qu’à bord la discipline n’est pas un vain mot ! »
Il me parut moins cordial, pour le coup.
On m’attribua une camisole usée jusqu’à la corde et une culotte large descendant jusqu’aux chevilles. Je remisai mon costume de commis aux écritures dans le sac de toile dans lequel j’avais jeté quelques effets et les Lettres anglaises. J’assurai mon premier quart. Les soutes étaient chargées, la cargaison amarrée. La plupart des matelots profiteraient jusqu’au dernier moment des plaisirs du port. De même l’embarquement des régiments interviendrait juste avant l’appareillage. Ne demeuraient sur L’Auguste que quelques officiers subalternes responsables du chargement et les rares marins qui préféraient le bord aux aventures des ruelles. Entendez qu’il ne leur restait plus un sol à donner aux filles et aux gargotiers ou qu’ils payaient quelque faute par la consigne. Apitoyé par mon embarras, l’un d’eux, un petit homme nerveux dont le regard gris surmontait un nez tordu, s’improvisa mon mentor. En premier lieu, il m’initia à l’art de chasser les rats. « Une malédiction pour un navire. Ils pillent la cambuse, percent les bailles d’eau douce et attaquent les caliers qui les dérangent. »
Armé d’un bâton, je me retrouvai préposé à la garde des amarres par où embarquent ces redoutables bestioles. J’eus la bonne fortune d’en assommer deux ou trois, ce qui me valut la considération de mon compagnon, qui se prénommait Augustin, mais répondait plus couramment au sobriquet de Bâbord-Amures. « À cause que mon nez a pris un coup de vent par ce côté-là », expliqua-t-il en montrant son arrête nasale déviée.
Je m’attachai vite à ce petit homme, originaire de Bayonne – j’ignorais encore que, dans la flotte, si les Bretons et les Provençaux se honnissent les uns les autres, ils se rejoignent dans le mépris des Basques. Il me racontait de fabuleuses histoires : « … À peine avait-on allumé le feu, que notre île se mit à bouger. Nous avons tout juste eu le temps de déhaler le canote : ce que nous avions pris pour un rocher était une baleine, la plus grosse baleine de tous les temps… » Je ne croyais pas un mot de ses récits, mais je ne demandais qu’à l’écouter. Il ne contait d’ailleurs pas que des fables et, par la suite, je me féliciterais à plusieurs reprises d’avoir suivi les conseils qu’il me prodigua dès ce moment. Ce fut lui, par exemple, qui m’indiqua où m’installer pour dormir. « Aujourd’hui, le vaisseau te semble vaste. Mais tu verras, garçon, quand ils seront tous là ! Tu le trouveras foutrement encombré. » La question n’était pas dénuée d’importance. Dans un bâtiment, chaque objet a sa place. La cargaison est solidement arrimée dans les soutes. La poudre est rangée dans la sainte-Barbe, au-dessus du gouvernail. Les fusils sont alignés dans des râteliers près de la salle du conseil. On confine le feu à trois endroits précis : la cuisine, pour cuire les aliments, la chambre du capitaine et l’habitacle du compas, pour les éclairer. L’équipage, en revanche, doit se débrouiller pour trouver un logement. On pend son hamac où on le peut : dans les cales, dans les entreponts, sous la dunette… L’abri le plus recherché est la batterie haute, située juste sous le pont : celui-ci protège des intempéries, l’air y est moins puant qu’ailleurs et la lumière pénètre par les écoutilles quand les sabords sont fermés. « La meilleure place, pour sûr. Aussi sûr qu’elle n’est pas pour toi.
— Et pourquoi donc ? m’écriai-je : ne suis-je pas à bord, quand les autres traînent dans les estaminets ?
— Tu crois donc que les premiers arrivés sont les mieux servis ? Ça ne se passe pas du tout comme ça ! N’oublie jamais que tu es un novice. Fais-toi petit. Prends exemple sur les rats : ils survivent aussi longtemps qu’on ne les remarque pas. S’ils deviennent trop hardis, couic !
— Mais toi, tu ne t’installes pas là-haut ? Tu es pourtant un ancien.
— Oh ! moi, je suis calier. Dès que nous aurons largué les amarres, tu ne me verras plus souvent sur le pont. »
Il prononça ces mots avec un soupçon de tristesse dans la voix. Cette nouvelle me glaça. En fait, je comptais sur Bâbord-Amures pour me guider dans l’existence nouvelle qui s’ouvrait à moi et qui, sans que je voulusse me l’avouer, m’effrayait un peu.
***
Le roman sort le 10 novembre en librairie.
Les éditions Argyll
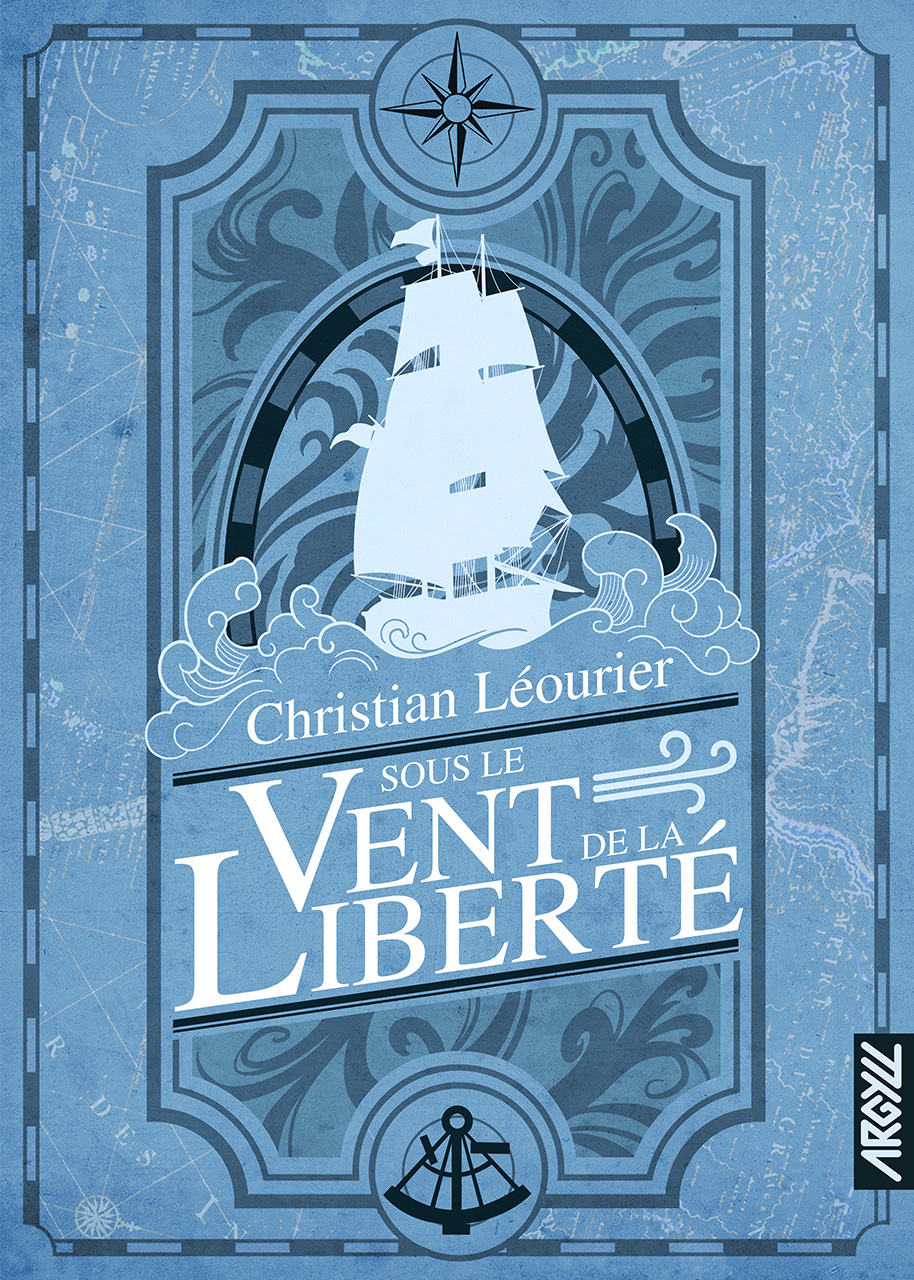 ">
">