Régulièrement, nous proposerons des tribunes d’auteurs invités sur ce blog qui apporteront une réflexion sur la façon dont fonctionne (ou devrait fonctionner) le monde du livre. Pour cette première livraison, faisons place à Camille Leboulanger, jeune auteur qui publie en début d’année 2021 un roman à la frontière des genres, Ru, aux éditions de L’Atalante. Il est déjà l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Enfin la nuit (L’Atalante) et Bertram le baladin (Critic/Libretto), Ru (L’Atalante). À venir chez Argyll : Le chien du forgeron, une puissante fantasy celtique qui s’attaque au mythe de… la virilité.

Quelles alternatives au contrat d’édition ?
Préambule : Il serait riche et pertinent de faire un historique du droit d’auteur et de la construction législative progressive qui a mené au « contrat d’édition » tel qu’il se pratique aujourd’hui. N’étant pas historien, je ne m’y risque volontairement pas afin de ne pas commettre de contresens.
L’article L 132-1 du Code de la propriété intellectuelle définit le contrat d’édition comme « le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication ou la diffusion. »
J’ai déjà longuement écrit sur les raisons pour lesquelles ce contrat me semble défectueux et pourquoi la rémunération proportionnelle qui est l’usage empêche la reconnaissance de l’auteur comme travailleur, entraînant nécessairement sa précarité et ce quel que soit le contrat signé. En effet, en régime capitaliste, la rémunération, appelée « salaire », est fondée sur une quotité horaire. N’importe quel auteur conviendra que sa rémunération n’est jamais en rapport avec son temps de travail1.
Les luttes de bonne foi d’organisations d’auteurs, comme la Ligue des auteurs professionnels (entendons « professionnel » comme « marchandisant leur travail », autrement dit « prolétaire ») sont majoritairement concentrées sur la détermination des « conditions » de contrat : pourcentage de rémunération, qualité, nombre, et durée de la cession des droits, etc. Ces efforts, toutes vertueuses qu’elles soient, ne remettent jamais en cause le contrat lui-même et le rapport de précarisation qu’il induit. Ce sont ce que Marx appelle des luttes « défensives » et non des luttes « offensives », visant à « renverser la table ». Un pourcentage de 12 % sur le prix HT de chaque exemplaire vendu est certes mieux que 6 %, mais il ne change rien au fond du problème.
Lors de la conception de leur contrat, les éditeurs d’Argyll, m’ont demandé parmi plusieurs autres auteurs mon avis sur leur document, me proposant de rayer ce qui me déplaisait ou de rajouter des propositions. Cette initiative est, elle aussi, vertueuse d’autant qu’il se débarrasse de l’à-valoir en proposant une « prime d’inédit » non liée aux ventes à signature du contrat. Malheureusement, il ne constitue seulement qu’un premier pas. Pour tirer les auteurs, comme les autres travailleurs, de la sujétion capitaliste, il est douloureusement indispensable de se débarrasser de la rémunération liée au contrat d’édition.
« Très bien, répondra-t-on, mais pour mettre quoi à la place ? »
Je vais laisser volontairement de côté la proposition du salaire à la qualification personnelle (aussi appelée « garantie économique générale ») défendue par Réseau Salariat, sur laquelle je me suis déjà beaucoup étendu.
Reformulons la question. Quelles structures de production permettraient aux auteurs de travailler et d’être « justement rémunérés »2 ?
Allons d’abord au plus simple. Transformons le contrat d’édition en contrat de commande, de type « CDD d’usage ». Un éditeur commanderait donc un roman à un auteur, pour une période donnée, possiblement avec des contraintes et des desiderata. L’auteur serait alors dans une position comparable à celui d’un réalisateur de cinéma par exemple. Cela se pratique déjà, sous forme de contrat de commande qui, payé « à terme », ne nourrit pas son auteur pendant le travail, puisque la rémunération arrive à terme. Imaginons que, pour un « CDD littéraire » de six mois, l’auteur soit rémunéré pendant cette durée. Cela semble souhaitable. Toutefois, cela ne résout pas le problème de la précarité et assimile le « marché du livre » au « marché du travail » dont on sait la violence. Cela renforcerait la concurrence entre auteurs, aspirants auteurs et irait dans le sens d’une surproduction plus intense. Et que se passerait-il entre deux contrats ? On peut imaginer un système semblable à celui de l’intermittence du spectacle, mais sur quoi le fonder ? Le nombre d’heures passées à écrire ?
Faisons un pas de plus. On peut imaginer que des maisons d’édition salarient à plein temps une écurie d’« auteurs maisons », qui pourraient même être formés « en interne ». Après tout, on le fait bien avec les sportifs. Au sein d’une industrie capitaliste du divertissement dans laquelle tous les « contenus » se valent et sont concurrents, et ce quelle que soit leur nature ou leur « valeur d’usage », il y a peu de différence entre la valeur produite par lire un livre ou regarder un match de football. Cette solution a au moins pour elle de rompre avec le fantasme de l’auteur « indépendant », magiquement hors de la division productive du travail, entrepreneur de lui-même. Pour prendre une autre image, quitte à être livreur de pizza en économie capitaliste, il vaut « mieux » (ou moins pire) être livreur salarié chez Domino’s3 que coursier Delivuber, assujetti au bon vouloir d’une application algorithmique. Quitte, donc, à être soumis à subordination (donc à désir maître, donc à violence) mieux vaudrait le « confort » d’un CDI à l’arnaque proposée par les plateformes types Amazon. Cependant, qu’arriverait-il à l’écrivain temporairement ou définitivement incapable d’écrire ? Que faire en cas de page blanche ? On voit difficilement Gallimard ou Hachette accepter qu’un de ses « poulains » reste indéfiniment sur le banc, dans l’attente du retour de « l’étincelle ». On protestera : « l’écriture est un muscle », « la régularité est maîtresse de sûreté », « deux-mille mots par jour, voilà le secret » ; autant de discours productivistes. Qu’importe ce qu’on écrit : il faut écrire. En cas de panne, en cas de « deadline » non tenue à répétition, le couperet tombera : licenciement, fin de contrat. Au mieux, reclassement chez une écurie concurrente, pour un salaire moindre. Autrement dit, la deuxième division, avant la troisième et tout au long de la descente, le spectre qui hante : celui de la « déprofessionnalisation », puis l’oubli, et entraîner les poussins du quartier. Oui mais, les gros paieront pour les petits, objecte-t-on, le mainstream paiera pour la marge, comme cela se fait déjà. Marc Levy paiera pour tous les autres, comme c’est déjà le cas.
On peut décliner le problème en cascade : pourquoi de plus petites entreprises, « à taille humaine », ne se chargeraient pas de fournir les grosses en texte à écrire ? De là, on imagine, non plus une myriade d’éditeurs autour desquels vivotent de RSA et de pourcentages des auteurs faméliques mais une bonne vieille pyramide de sous-traitance où la base fournirait le haut en matériel à lui refourguer ensuite. Mais au moins, les heureux élus auraient pu décrocher un sacro-saint contrat, au mieux à durée « indéterminée » (comprendre « pas perpétuel »). Là encore, rien que du déjà vu, du vieux sous l’aspect du neuf : voir Willy, de Colette et Willy, l’entrepreneur littéraire et son armée de prête-plumes. Comme disait le poète : « Non, merci ».
Mais alors quoi ? Le contrat d’édition serait-il le mieux, le meilleur compromis ? Est-ce encore la fable du compromis social-démocrate détricoté par des gouvernements de plus en plus rapaces, décomplexés ? Si le travail de création littéraire n’est pas quantifiable (selon l’échelle horaire de la valeur capitaliste), s’il n’offre aucune sûreté de rendement, si on ne peut même pas exiger d’un travail en littérature qu’il travaille constamment, même pour lui assurer un salaire ? On arrive à une aporie. Il n’y a pas en régime capitaliste d’alternative satisfaisante au contrat d’édition parce que celui-ci n’est que la conséquence, une forme même un peu avancée de la subordination du travail au capital et les autres propositions de même. Le contrat d’édition, les pourcentages bas, la précarisation, le malheur et la pauvreté du plus grand nombre ne sont pas des dysfonctionnements mais, au contraire, des conséquences logiques, des effets de système, même des principes en action ; des finalités. Que les auteurs crèvent la dalle, c’est normal. Business as usual. 6 % ou 12 %, qu’importe au fond le calibre des miettes qu’on leur jette ? Ces crevards-là sont si complaisants qu’ils en ont même fourni la fiction romancée, romantique : l’artiste, la bohème, la chambre sous les toits et, après la mort misérable, le tiroir rempli de lumières insoupçonnées.
Puisque toutes les voies examinées nous ramènent à notre point de départ, il ne reste finalement que celle qu’on a laisséede côté. Plutôt que de se plaindre de n’être même pas, même plus invité à la table, la renverser.
Camille Leboulanger, 2021
1voir articles précédents
2Laissons ces définitions de côté : disons, « une rémunération qui permet de vivre dignement ».
3Voir la séquence d’ouverture du film Attention Danger Travail de Pierre Carles : https://www.youtube.com/watch?v=eCfkpzhcE2Q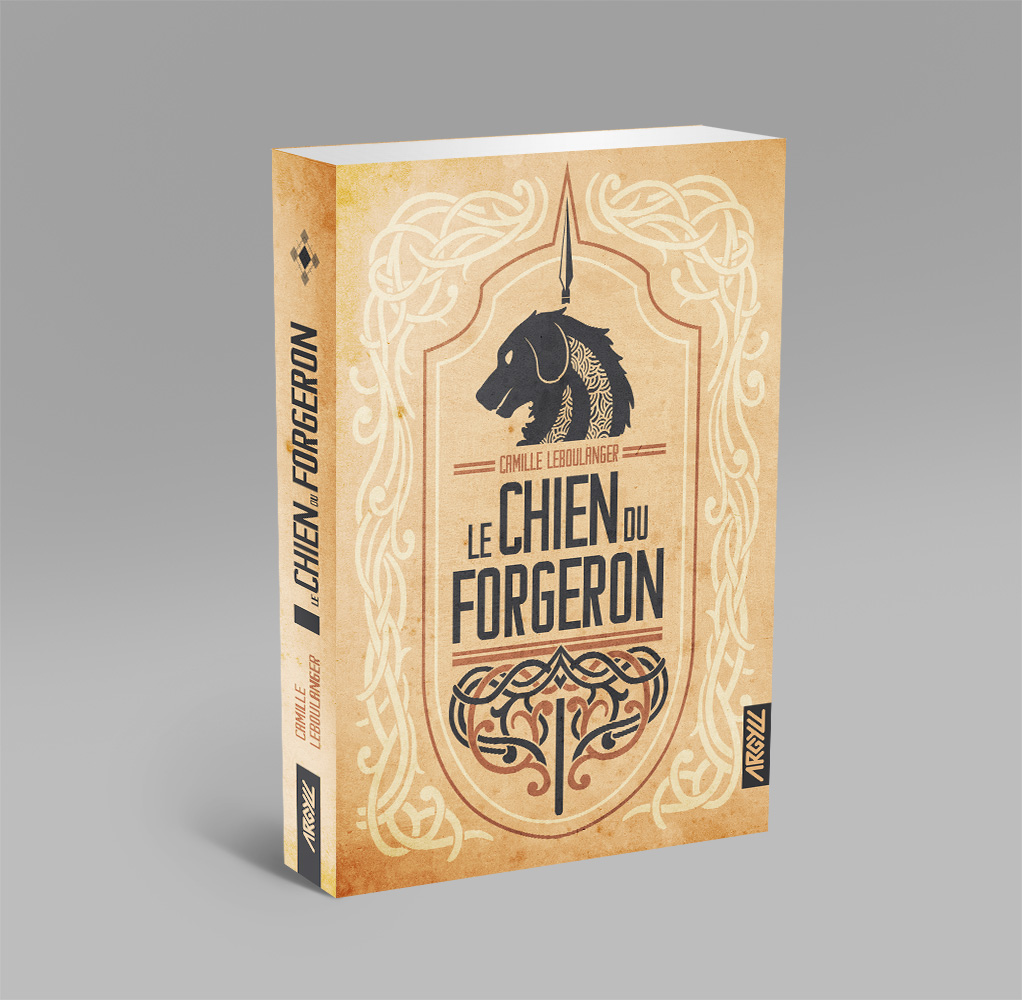
 ">
">