
❝ Camille, on ne te présente plus, Le Chien du Forgeron est ton cinquième roman publié. Il s’agit d’un roman hybride, pas totalement de la fantasy, pas totalement de l’historique. Pourquoi n’avoir choisi ni l’un ni l’autre ? Une question de liberté de ton ? Ou alors les genres et les étiquettes te serrent trop la taille ? ❝
𓃥 Cette question du genre et de l’étiquette me suit depuis mes débuts en édition. Elle m’a été posée dès Enfin la nuit (chez l’Atalante). On a souvent dit des textes que j’écris qu’ils sont « au croisement », dans « l’entre-deux ». En réalité – j’y reviendrai – je ne me la pose moi-même jamais, si ce n’est comme en effet la matérialisation de frontières, de limites qui effectivement me gênent, non dans l’écriture, mais dans la commercialisation des livres.
Pour revenir à ta question, si Le Chien du Forgeron n’est pas un roman historique c’est en grande partie par manque de source. J’ai choisi de faire se jouer l’histoire dans un VIIIe siècle avant J.-C. largement fantasmé… par manque de sources. En effet, il semble que la civilisation celte irlandaise n’a laissé que peu de trace et les sources qui la mentionnent sont étrangères (grecques, notamment) et postérieures. On m’a d’ailleurs déjà fait remarquer plusieurs « incohérences » dans le texte, quant au mode de vie des celtes (bâtiment, alimentation…) mais cela ne me tracasse pas. C’est une fiction. Il n’y a pas de règle en fiction.
Pour ce qui est de la fantasy, je ne connais pas de définition suffisamment précise et opérante de ce terme qui me permette de me situer par rapport à ce genre.
Le Chien du Forgeron est pour moi la réécriture réaliste (au sens littéraire du terme) d’un mythe. À ce titre, j’ai dû aborder de nombreux aspects matériels du monde décrit et leur effet sur les personnages. Ce n’est pourtant pas un roman dénué de magie, à mon sens, ou du moins de mystère et d’inexplicable.
❝ Cuchulain est une figure celte importante. Pourquoi avoir choisi ce personnage (outre ton amour pour Manau) en particulier ? ❝
𓃥 J’ai effectivement, comme beaucoup d’enfants français de ma génération, découvert cette histoire via la chanson éponyme sur le premier album de Manau. Ce n’était pas ma préférée de l’album, je dois dire, mais le choix offert au Chien m’est resté en mémoire : la mort et la gloire ou la vie et l’anonymat. Je l’ai redécouverte des années plus tard par un morceau de musique de Jeff et Mychael Danna intitulé The Blood of Cu Chulainn. Je me souviens avoir écrit une première version de cette histoire pour un devoir d’Option Cinéma Audiovisuel au lycée (Mme V. , M. P. , si vous me lisez, je vous salue !). Disons pour faire simple que cette histoire me travaillait depuis longtemps.
Le texte s’est présenté, comme souvent, au milieu de la rédaction d’un autre livre. Je me souviens avoir d’abord trouvé le dispositif narratif avant même de me mettre à faire des recherches plus poussées sur ce mythe. J’ai quasiment tout de suite su que le texte serait une parole interrompue, s’ouvrant et se fermant par des guillemets.
Je me suis rendu compte qu’il n’existait que très peu (voire aucune) de versions de l’histoire écrite en français, contrairement aux légendaires gréco-romains ou égyptiens, par exemple. Ce mythe est extrêmement populaire, voire « évhémérisé » en Irlande, pour ce que j’en comprends.
La claustration forcée du printemps 2020 m’a donné l’occasion de m’y mettre. C’est un roman du « confinement » et du « déconfinement ». Sa première moitié a été écrite enfermée, la deuxième le plus dehors possible : au bord de la Vilaine, dans des parcs.
Le personnage du Chien lui-même m’intéressait car, pour la première fois, je racontais l’histoire d’un personnage pour lequel je n’éprouvais (presque) que de l’antipathie. Il me permettait de questionner la construction du héros.

❝ Si tu devais présenter les ambitions de ce roman, que dirais-tu ? ❝
𓃥 Je dirais tout d’abord qu’il s’agit d’un portrait. Nous suivons le Chien, des circonstances particulières précédant sa naissance jusqu’à (attention, divulgâchage) sa mort. Sa première ambition est de raconter comment le Chien devient le Chien : quelles sont les forces qui ont agi sur lui pour faire de lui qui il est et, en retour, quelles conséquences ses actions ont eu sur le monde.
Je parlais plus haut d’antipathie envers Cuchulainn. Il m’est apparu, au cours de l’écriture, que ce texte était un roman anti-viriliste. Je suis depuis très jeune mal à l’aise avec les représentations et les impératifs sociaux liés au « masculin » : sportivité, force physique, responsabilité, courage, etc. Toutes ces qualités, je ne les possédais que maigrement. Mes intérêts allaient aux livres, à la musique, à la contemplation. J’ai longtemps été plus à l’aise en compagnie de femmes que d’hommes et ce non seulement à cause de mon hétérosexualité. J’ai passé un Bac Littéraire : nous étions quatre garçons pour vingt filles. Le fait de porter un prénom épicène n’a sans doute pas dû aider. Dans mon enfance, « Camille la fille » m’était adressé comme une insulte, par exemple.
Or, Cuchulainn, comme de nombreux antiques produits de sociétés patriarcales, est un héros viril : fort, rapide, conquérant. Ses attributs sont phalliques : la lance, la foudre. C’est cette masculinité là dont parle le livre, par le biais du Chien. Elle est violente pour ses proches et pour lui-même. Surtout, elle est une construction sociale qui finit, en la personne du Chien, par être hors de contrôle. À ce titre, j’ai été frappé par l’écoute d’une intervention radio d’Olivia Gazalé, autrice de Le Mythe de la Virilité : un piège pour les deux sexes qui m’a beaucoup aidé dans la compréhension du personnages.
Toutefois, si je ne cache pas (et le narrateur, qui est un des – sinon le – personnages les plus important du roman non plus) mon aversion pour le Chien, le roman est la réécriture d’un mythe sans âge par un auteur du XXIe siècle. En cela, il est nécessairement de parti pris et, comme un historien peut-être, il faut se garder de le juger à l’aune de nos savoirs et chercher plutôt comment ses actes nous informent, ce qu’ils peuvent nous apprendre.
❝ Es-tu de ceux qui pensent que les littératures de l’imaginaire (si elles existent) permettent ce pas de côté nécessaire à réveiller notre réalité, notre quotidien ? Comment ? ❝
𓃥 Je ne sais pas si les littératures de l’imaginaire existent. Je sais qu’il existe une certaine quantité de textes littéraires que le complexe éditorial capitaliste a choisi de libeller avec ce terme. En réalité, ce me semble être un mot « tout prêt » qui ne me paraît pas vouloir désigner de concept ou de réalité tangible.
Je me permets un petit exemple pour appuyer mon idée. Voici deux énoncés :
D’une part : « Mohammed débarqua en Gare de Lyon à 15h57. Il découvrit avec amertume que Sandra, avec laquelle il avait longuement échangé sur Tinder, ne l’y attendait pas. »
D’autre part : « Althus débarqua sur le Port d’Ostracopolis au quatrième décan. Il découvrit avec amertume que Meriout, avec laquelle il avait longuement correspondu via l’ansible, ne l’y attendait pas. »
Hors des choix lexicaux, il n’y a aucune différence fondamentale dans la construction grammaticale de ces phrases. Certes, la première nous est plus familière. La seconde exige du lecteur un effort plus important pour être comprise, décodée. La première serait qualifiée de « littérature blanche », « réaliste ». La seconde serait rangée dans la catégorie de la science-fiction, de la fantasy, voire dans un sous-genre plus précis, que sais-je encore. Elle paraît offrir, c’est vrai, un « décentrement » plus radical.
Mes exemples sont volontairement simplistes, caricaturaux, mais ils me permettent il me semble de révéler une chose : l’imaginaire et son « contraire » la « blanche » sont au mieux des préconceptions du lecteur, teintant son horizon d’attente, au pire des noms de rayon.
En tant qu’écrivain, les noms de rayon ne me concernent pas. La réception du lectorat forcément un peu plus. Toutefois, je pense que pour aborder sereinement le champ de la littérature (ou de la musique, ou du cinéma) il faut se défaire le plus possible de ces catégories qui se sont pas des concepts analytiques mais des catégories arbitraires.
Je risque une lapalissade : toute fiction est imaginaire ; toute fiction est altérité radicale. À ce titre, toute fiction dit quelque chose du monde (sans parler, évidemment, de porter le sachant ou non une idéologie, comme le disait ici Christophe Nicolas), de son auteur et de son lecteur.
Disant cela, je ne cherche absolument pas à réduire la « science-fiction » à une sous littérature mais au contraire à la rendre égale à tout le reste. Je dis souvent : « Il n’y a que deux catégories de livres/films : les bons et les mauvais.»
Les autres considérations appartiennent au régime de la réception, qui ne me concerne pas en tant qu’écrivain.
❝ Dans quelle mesure, si c’est bien le cas, la lecture est-elle chez toi un facteur déclenchant du besoin d’écrire? ❝
𓃥 Je ne crois pas être un très gros lecteur, et encore moins un gros lecteur de fiction. Il peut se passer des jours, quelquefois des semaines sans que j’ouvre un roman. J’ai d’ailleurs beaucoup de mal à suivre l’actualité des parutions. Les essais ont une plus grande part, je crois, dans mon travail d’écrivain que les « romans des autres ». Cependant, il me semble que les deux choses sont liées d’une manière très intime. Il me semble que, dès le moment où j’ai su lire, j’ai écrit, d’une manière ou d’une autre. Je ne saurais dire, cependant, qui a « déclenché » l’autre.
En tout cas, la lecture de fiction permet de questionner ma propre pratique : telle manière de faire, tel pli stylistique, telle situation d’énonciation, etc. Je tends à avoir un rapport très distancié à la fiction que je lis. On m’a souvent reproché une grande distance émotionnelle avec les personnages que je décris. Cependant, c’est ainsi que je reçois les textes des autres. Plus j’avance, moins j’arrive je crois à « débrancher » mon œil d’écrivain quand je lis (en fiction, en tout cas).
Quelque fois, pourtant, les lectures offrent la forme qui permet à une idée de devenir un texte. Mon roman Malboiren’aurait pas existé sans les Mémoires d’Hadrien qui m’ont donné le point de vue et, dans une certaine mesure le rythme. Pour Le Chien du Forgeron, je voulais revenir à une certaine oralité et, dans cette mesure, il constitue une sorte de suite thématique de Bertram le Baladin (chez Critic) qui traitait déjà de la force des récits, par le prisme de la musique et de la chanson (qui est une autre forme, plus abstraite, de récit).
Il y a une phrase de Jacques Rivette, je crois, qui dit que chaque film est documentaire sur son propre tournage. De la même manière, j’aurais tendance à penser que chaque roman est un portrait en creux de son auteur et des conditions dans lesquelles il l’a écrit.
❝ Et d’ailleurs, quelles sont les lectures que tu considères importantes, voire vitales, dans ton propre parcours d’écrivain ? ❝
𓃥 Kim Stanley Robinson a dit « La science-fiction est le réalisme de notre temps ». Ce n’est pas par hasard, je crois, si j’aime autant cet auteur que Zola. Le XIXe siècle est le moment littéraire vers lequel je me retourne le plus quand j’ai besoin de lire quelque chose de confortable, de « rassurant ». C’est en cela, je crois que je n’arrive plus à penser à mon travail d’écrivain qu’en tant que réaliste. Je suis un réaliste d’endroits qui n’existent pas.
Cela, je le dois il me semble tout d’abord au Seigneur des Anneaux. J’avais dix ans quand le film est sorti, j’ai dévoré les trois romans en quinze jours : une porte venait de s’ouvrir. Ce roman fait partie de ces livres que je relis régulièrement. Je n’ai que peu de souvenirs, positifs comme négatifs, de mes lectures scolaires, à l’exception de L’étranger de Camus, de Cyrano de Rostand et de la découverte de Zola avec La Curée puis La Joie de vivre. J’ai eu la chance d’étudier Les Pensées de Blaise Pascal en Terminale et cela m’a marqué durablement.
J’ai lu beaucoup de SF en même temps, pillant absolument les CDIs et bibliothèques des alentours. Ce n’est plus une surprise pour personne mais Kim Stanley Robinson est pour moi un des plus merveilleux auteurs vivants. Years of Rice and Salt est un de ces romans que j’aimerais avoir écrit. La trilogie de Mars me hante toujours, après l’avoir lue en trois occasions. En remontant le même fil, je suis arrivé tardivement à Le Guin, après sa mort malheureusement. Je ne cesse depuis de conseiller Les Dépossédés à tort et à travers. Son livre sur l’écriture, Mener sa barque fait d’ailleurs partie des rares ouvrages de ce genre que je recommande, bien qu’il ne s’adresse pas vraiment à des débutants.
De manière générale, j’éprouve une grande satisfaction à lire les œuvres de gens « meilleurs » que moi. J’ai récemment lu À la ligne de Joseph Ponthus, tout à fait par hasard et j’ai pris une baffe terrible. Il arrivait à faire en quelques lignes seulement, plus clairement et plus efficacement, ce que j’avais mis des pages entières à approcher. C’est une leçon d’humilité et une leçon tout court. Par chance, j’aime apprendre.
J’ai un parcours sinueux. Je n’ai pas fait d’études de littérature et je le regrette parfois. Il faut cependant reconnaître aux parcours sinueux une qualité : c’est qu’ils permettent de découvrir de nombreux paysages différents, même si la destination est souvent incertaine. Cependant, pour paraphraser Morpheus dans The Matrix, il compte moins à mes yeux de connaître le chemin que d’arpenter le chemin. ◉
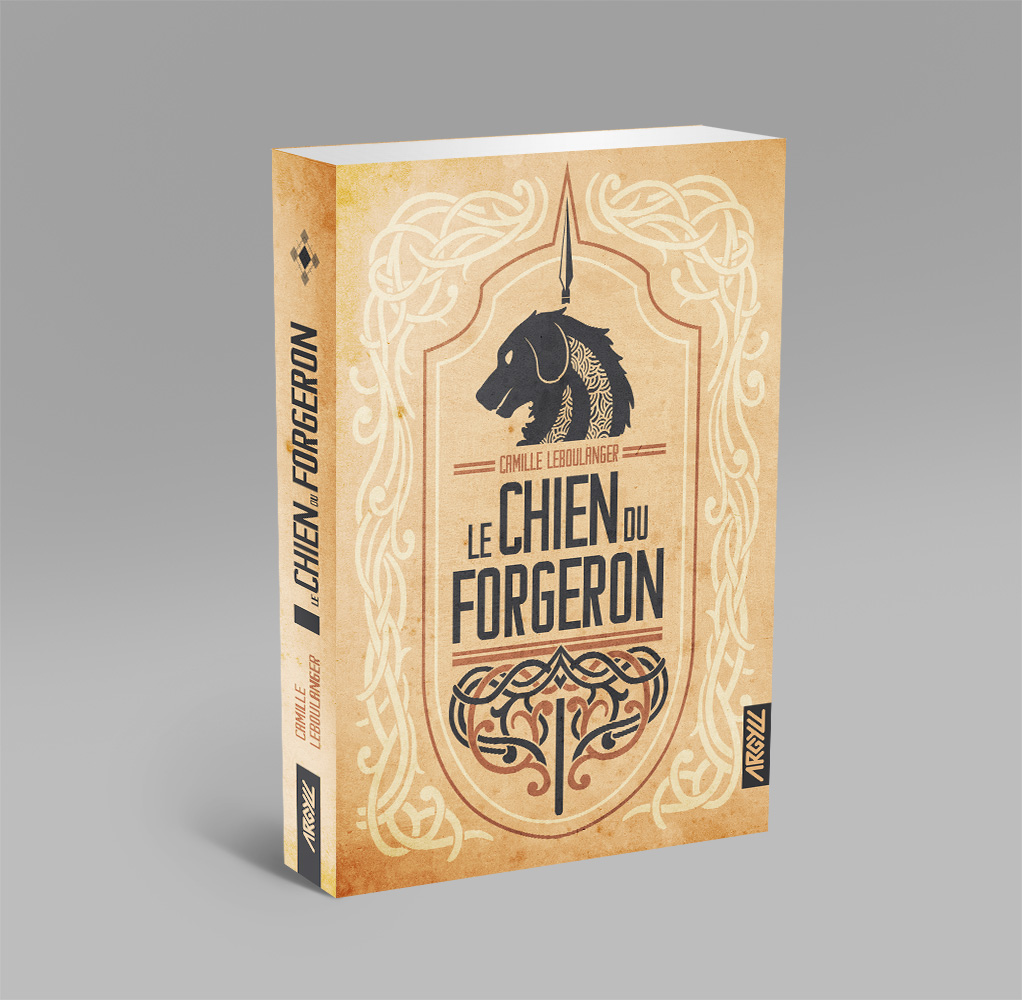 ">
">