Par son ambition littéraire et son souffle romanesque, “Sous le Vent de la liberté” évoque autant les classiques du roman d’aventure – A. Dumas, R. L. Stevenson, J. F. Cooper – que ceux du roman maritime – C.S. Forester, P. O’Brian, P. McOrlan. Il dépeint avec maestria le désordre qui règne à la fin du XVIIIe siècle, moment charnière de l’Histoire, tandis que le monde, en proie à différents courants philosophiques, politiques et économiques, voit souffler un vent de révolte – un vent de liberté.
Ce n’est pas nous qui le disons, mais la quatrième de couverture. Alors, pour vous allécher, pour vous donner envie de découvrir ce roman aux allures de classique instantané, nous allons pendant un mois vous partager les 5 premiers chapitres du roman, actuellement en précommande sur notre site internet (toute pré-commande sera dédicacée par l’auteur).
Trêve de parole, la mer est paisible, le vent souffle vers ailleurs, il est l’heure d’embarquer…
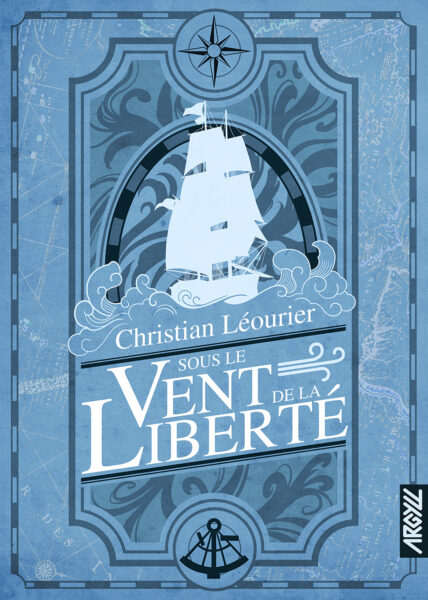
Chapitre 1
Le char de l’Ankou
Le manoir de Kervadec ne ressemblait en rien aux gracieuses gentilhommières, flanquées d’une chapelle et d’un pigeonnier que, depuis le Grand Siècle, les architectes de Rennes ont accoutumé d’ériger dans notre province. Une tour coiffée d’une poivrière, une autre à demi effondrée, des murs épais à peine égayés par les ouvertures que la Renaissance y avait percées témoignaient de son passé militaire. S’il avait jadis résisté aux assauts des soldats, mon enfance le voyait succomber à ceux du temps. La charpente creusait, le toit fuyait en maints endroits et, les nuits de tempête, le vent s’engouffrait par mille fissures dans les galeries. D’anciennes gravures montrent un parterre aménagé à l’italienne au regard de la façade occidentale. Ce sage ordonnancement, s’il fut jamais réalisé, avait depuis longtemps disparu. Désormais, le blé poussait jusqu’aux abords de la terrasse, laquelle recevait plus souvent la visite des poules que celle de la noblesse des environs. Telle quelle, solitaire et patinée comme un rocher de la lande, cette austère bâtisse de granit gris, moins exiguë que les fermes des alentours mais à peine plus confortable, était bien l’antre qui convenait au marquis Armel Hoel de Kervadec, mon père.
Le marquis s’enorgueillissait de quartiers remontant à Nominoë. Il ne pouvait en revanche tirer vanité de sa fortune. Le domaine familial, autrefois étalé sur deux paroisses, se réduisait désormais à la demeure ancestrale qu’il n’avait plus les moyens d’entretenir et à quelques terres attenantes. Pourtant, si, comme de nombreux gentilshommes de notre âpre Bretagne, mon père menait une existence qui ne se démarquait guère de celle de ses métayers, il le devait autant, sinon davantage, à son attachement aux doctrines des philosophes qu’à la médiocrité de sa fortune. Toute sa vie, il caressa un rêve : arracher des moissons abondantes à une terre qui s’en montrait par nature très avare. Il se procurait des semences et des tubercules dans tous les ports d’Europe grâce à la diligence de correspondants aussi enthousiastes que lui, et tenait pour assuré que le salut de l’humanité dépendait de l’un des plants qu’il choyait sans jamais se décourager. « Quand les hommes ne craindront plus la faim, affirmait-il, quand la terre donnera avec générosité tout ce que l’on peut espérer d’une mère, les guerres disparaîtront, car chacun vivra dans la paix et l’harmonie de la nature, comme aux premiers temps de l’humanité. » Pour mener ses expériences, il ne dédaignait pas de pousser lui-même la charrue, vêtu comme l’un de ses paysans et sabots aux pieds. Une aberration qui inspirait à ses voisins de la méfiance, voire du mépris.
Tout aussi suspect à leurs yeux paraissait son goût immodéré pour la lecture. Sa bibliothèque constituait sa fierté, sa passion, son bastion. Peut-être lui aurait-on pardonné cette manie s’il s’était consacré aux ouvrages pieux ou aux auteurs édifiants. Mais à Bossuet, Bérulle ou Fénelon, il préférait Montesquieu, Rousseau, Raynal, voire ces libertins en vogue à Paris, dont on murmurait avec effroi dans notre province qu’ils raillaient le clergé, malmenaient la morale et se mêlaient de bousculer un ordre consacré par Dieu et conforme à la nature. À qui lui en remontrait, il répliquait, sur le ton de la colère : « La liberté d’imprimer est la première des libertés ! » C’était employer deux fois dans la même phrase un mot dont ses pairs se défiaient.
Tant d’extravagances scandalisaient. On craignait, à fréquenter un tel exalté, de se compromettre. Peu à peu, le vide se creusa autour de lui. Il n’en avait cure. Depuis que son épouse reposait à l’ombre du calvaire, dans l’enclos paroissial, il vivait en ermite, ne supportant auprès de lui qu’un couple de domestiques âgés et moi, son cadet, auquel il entendait communiquer sa foi dans la grandeur de l’homme. Car ce solitaire préoccupé du bonheur de ses semblables les aimait, à défaut d’en rechercher la compagnie.
Le marquis de Kervadec, dont les lointains ancêtres s’étaient illustrés à Ballon et à Jengland, ne montrait aucun goût pour le maniement des armes et nul ne se souvenait d’avoir vu pendre à sa ceinture l’épée à laquelle ses quartiers de noblesse lui donnaient droit. Cependant, il m’enseigna les rudiments de l’escrime, car il était acquis qu’une personne de condition ne saurait en ignorer la pratique. Tout en m’initiant à la feinte et à la parade, il me rappelait qu’un gentilhomme, dans la nécessité de défendre sa vie, ne doit pas craindre d’enferrer son adversaire, mais se fait un point d’honneur de ne le toucher qu’à la poitrine et que l’élégance du geste doit demeurer le premier souci du duelliste. J’avais appris, en me frottant aux gamins des paysans, d’autres luttes et d’autres mœurs, qui pour être moins policées n’en étaient que plus efficaces, et je maniais le penn-baz mieux que l’épée. Je le cachais à mon père, redoutant qu’il ne désapprouvât mes escapades, et encore plus ces empoignades de manants. Et je me pliais volontiers à ses leçons qui resserraient le lien qui nous unissait. Il s’était à vrai dire noué assez tard. Longtemps, en effet, le marquis m’était apparu comme un être lointain, fantasque, oscillant entre la mélancolie et l’enthousiasme. J’avais poussé dans les jupes de Melle, la servante. Jusqu’au jour où, levant la tête de ses livres, Monsieur de Kervadec découvrit avec consternation qu’il avait pour dernier rejeton un sauvage hirsute qui gambadait les pieds nus, n’aimait rien tant que grimper dans les chênes du bosquet et s’exprimait le plus souvent en breton sans savoir épeler le moindre mot de ce jargon, pas plus que du français. Cette découverte l’étonna comme s’il s’éveillait d’un long engourdissement ; de fait, il ne manifestait qu’indifférence pour ce qui l’entourait depuis le jour où son épouse avait perdu la vie en me donnant naissance. Ce fils auquel il n’avait jamais prêté attention lui apparut comme une chance qui lui était offerte de démontrer la justesse de ses théories. De même qu’il cherchait une céréale d’un nouveau genre, de même il voulut voir dans l’enfant au front têtu qu’effarouchait l’intérêt soudain qu’il lui portait la graine de l’humanité nouvelle dont ses livres prédisaient l’avènement. J’étais né le jour même où le conseil du roi prononça la réhabilitation de Calas. L’incrédule y voyait un appel du destin.
Le marquis s’affirmait libertin et ne perdait pas une occasion de brocarder les prêtres. Pourtant il confia mon éducation au recteur de la paroisse, le Père Milon, un homme aussi rond dans ses manières qu’anguleux dans sa physionomie. Ses ouailles attribuaient sa maigreur à une sainte pratique des mortifications et son prestige s’en trouvait accru auprès d’elles. Un homme devenu aussi léger n’était-il pas déjà un peu un ange ? L’évêque, en revanche, désapprouvait un zèle qu’il jugeait excessif, surtout chez un prêtre d’origine roturière à qui on ne demandait rien d’autre que de rappeler les fidèles à leur mortelle condition, d’encourager les femmes à la modestie, les hommes au labeur, et de dire l’office. Le P. Milon s’amusait de l’une et l’autre opinion. À l’entendre, sa maigreur tenait simplement à la constitution dont la nature l’avait doté. « Je pourrais manger plus que de raison sans grossir d’une once », souriait-il. Je lui en donne volontiers quittance, bien qu’il n’eût jamais l’occasion de démontrer cet appétit à Kervadec, où la frugalité qui présidait aux repas devait moins à la modération chrétienne qu’à l’impécuniosité.
Mon père se plaisait à taquiner l’abbé sur telle ou telle contradiction du dogme ; en contrepartie, celui-ci le mettait régulièrement en garde contre la damnation qui guettait les libres penseurs. Mais ils se ressemblaient trop, d’une certaine manière, pour ne pas s’estimer. Tous deux caressaient l’espoir de voir l’humanité atteindre un jour au bonheur. Ils divergeaient seulement sur les voies à emprunter. L’abbé cherchait le chemin dans les Écritures, tandis que mon père accordait sa confiance aux ouvrages des philosophes. L’un invoquait la grâce, l’autre la raison. Et chacun d’eux comptait sur moi pour illustrer ses convictions. Le matin, donc, l’abbé m’invitait à méditer sur les Actes des Apôtres et les textes de saint Augustin, mais aussi sur les auteurs grecs et latins, qu’il chérissait bien qu’ils fussent païens. Le soir, mon père me lisait des passages de Bayle, Helvétius ou Voltaire. Au dernier surtout, il vouait une admiration sans borne. Je ne comprenais pas tout, mais j’aimais à le rejoindre après dîner dans la bibliothèque, la seule pièce chauffée l’hiver – non pour le confort, mais parce que les livres craignent l’humidité. Entre autres trésors, on y trouvait les trente-cinq volumes de l’Encyclopédie. Tandis que mon père les consultait, je laissais mon imagination courir en contemplant les gravures qui les illustraient. Je m’attardais en particulier sur les planches consacrées à la marine, fasciné par le nom étrange des mâts et des gréements, et plus encore par les évolutions navales, où de petits vaisseaux se déplaçaient sur des figures géométriques. De temps en temps, levant la tête de son livre, mon père s’enflammait en m’expliquant comment l’ingéniosité des hommes, venant à bout des tâches les plus ardues, finirait par imposer la justice et la paix. Contrairement aux autres personnes qui m’étaient familières, il ne redoutait pas le changement ; il usait volontiers, pour le désigner, d’un mot nouveau : le progrès, qui proclamait que demain serait plus clément qu’hier.
S’il ne recevait personne, le marquis échangeait en revanche une correspondance abondante, notamment avec des botanistes qui, dans l’Europe entière, s’intéressaient comme lui aux cultures novatrices. Mais rien ne le réjouissait davantage qu’une lettre de M. Maulevain, son libraire de Troyes, lui annonçant la dernière livraison d’ouvrages qu’on disait imprimés en Hollande ou à Genève pour déjouer la censure. Il n’hésitait jamais à interrompre la leçon du P. Milon pour m’annoncer cet événement, qui précédait souvent la disparition de quelque pièce de notre mobilier. Mon précepteur ne s’autorisait aucun commentaire, mais tendait, impérieux, son interminable index vers le texte posé devant moi : il était, lui, du parti qui se méfiait des innovations et n’accordait sa confiance aux livres que lorsque les siècles et l’Église en avaient consacré la sagesse.
Mon père recevait aussi, de loin en loin, d’autres lettres. J’en devinais l’auteur à la tristesse qui s’emparait alors de son regard. Mon frère Yves était bien plus âgé que moi. Ma mère était encore de ce monde quand il prit la mer. Mon père ne tolérait pas d’entendre prononcer son nom ; cela disait assez que mon frère s’était embarqué sans son consentement. J’ignorais quelles affaires Yves brassait sur l’autre rive de l’océan. Je tenais un peu rigueur au marquis de son silence. Car, pour l’enfant que j’étais, ce mystérieux aîné parti courir fortune aux Amériques devint bientôt un héros secret, un Ulysse des temps modernes. Peut-être, à l’instar d’Énée, fonderait-il une ville appelée à régner sur l’univers. Cette légende que construisait mon imagination n’était sans doute pas étrangère à l’attrait que les navires exerçaient sur elle. Je tentais bien, quelquefois, de surprendre une de ces lettres. Mais mon père les enfermait sitôt lues dans un coffret de marqueterie dont lui seul détenait la clé.
Jamais je n’essayai de forcer la serrure de cette cassette, exposée en évidence dans la bibliothèque, tel l’arbre de la connaissance au centre du jardin d’Eden. Je redoutais moins de provoquer le courroux de mon père que de le blesser en trompant sa confiance. Néanmoins, ma curiosité était mise à rude épreuve et j’espérais, comme un chat guette un geste maladroit de la cuisinière, qu’une négligence m’offrît une occasion de la satisfaire. Elle ne vint jamais. À plusieurs reprises, je m’efforçai de soutirer un renseignement au P. Milon. Un jour, excédé par mon insistance, il déclara : « S’il est de la volonté de Dieu de ramener le fils au père, alors ils se réconcilieront. Même un négrier ne doit pas désespérer de la divine Providence ! » Il en profita pour me faire traduire en grec la parabole du fils prodigue. Et, tandis que je m’appliquais à en calligraphier les caractères, je me demandais si mon maître avait proféré une maxime d’ordre général, ou s’il s’agissait d’une allusion au négoce de mon frère, dont je ne discernais d’ailleurs pas en quoi il méritait la réprobation du marquis.
Puisque j’en suis venu à évoquer mon éducation, je manquerais d’exactitude, et de reconnaissance, si je n’évoquais pas Jakez, l’époux de Melle. Pas plus qu’elle, il ne savait lire et je ne l’ai jamais entendu parler une autre langue que le breton, bien qu’il entendît le français. Il possédait tous les corps de métier, à en croire les nombreuses réparations qu’il réalisait. Le soir, il s’asseyait près du feu l’hiver, devant la porte l’été, et sculptait dans du bois, au couteau, des toupies et des animaux de toutes sortes qui furent mes seuls jouets. Je m’asseyais à son côté, surveillant l’avancement de son travail. Je comprenais vaguement que les histoires qu’il me racontait tout en taillant son bestiaire étaient d’une autre nature que les contes dont Melle avait bercé ma tendre enfance. Elles étaient peuplées de géants, de korrigans et de dragons, et aussi de saints dont le P. Milon ne parlait jamais et avec lesquels Jakez paraissait avoir noué d’étroites relations, car il les traitait avec une grande familiarité. Comme il réparait les articulations déboîtées aussi bien que les timons brisés, il passait pour un peu sorcier.
Tels furent mes trois maîtres. Alexandre le Grand n’en eut pas de meilleurs.
Aux environs de 1775, mon père s’enticha des colons de l’Amérique du Nord, entrés en rébellion contre le roi d’Angleterre. Selon lui, les Insurgents jetaient les bases d’une société idéale, fonctionnant selon les principes d’égalité et de fraternité préconisés par ses chers philosophes. Le monde, instruit par l’exemple de ces précurseurs auxquels il prêtait toutes les vertus des Romains de la République, ne tarderait pas à connaître un nouvel âge d’or. « Tu verras, prédisait-il, ils lèveront bien haut la torche qui éclairera tous les hommes. » Il n’excluait d’ailleurs pas les Anglais de ce partage car, loin de professer l’exécration où il était de bon ton de les tenir en Bretagne, il accordait son estime à un peuple qui, malgré sa détestable habitude de chercher querelle aux Français, n’en avait pas moins accueilli Voltaire quand celui-ci risquait la Bastille, et dont de nombreux philosophes, à commencer par ce dernier, louaient les institutions politiques.
Il éprouva une grande joie en apprenant qu’un jeune enthousiaste, le marquis de La Fayette, s’était engagé aux côtés des Insurgents, malgré l’opposition du roi, que les idées avancées des Américains effarouchaient. Il n’alla cependant pas jusqu’à suivre son exemple. Mon père, je l’ai dit, n’avait rien d’un guerrier. Il se contenta de caresser l’idée de traverser l’océan pour participer à la construction de ce pays une fois brisé le joug britannique.
Peut-être aurait-il fini par s’embarquer, si la Providence n’en avait décidé autrement.
Le marquis Armel Hoel de Kervadec avait vécu en paysan. C’est en paysan qu’il mourut. Ce triste événement, qui allait tant infléchir ma destinée, intervint passé l’Assomption de l’an 1780, au terme d’un après-midi alourdi par l’orage. Dès le matin, le ciel avait pesé sur les chaumes avec un éclat métallique. Dans les écuries, les bêtes s’agitaient sous la piqûre des taons. Les nuages s’épaississaient. Il faisait pour ainsi dire nuit, ce qui rendait plus sublime encore le spectacle des éclairs tendus entre le ciel et la lande. Vers cinq heures, enfin, les nuages crevèrent. L’air était si chaud, si moite, que j’entendis avec soulagement les premières gouttes s’écraser dans la poussière. Puis la pluie se mit à tomber en trombes. Soudain, un coup de tonnerre plus terrible que les autres secoua les hauts murs de Kervadec. Mû par quelque pressentiment, mon père courut à la fenêtre et l’ouvrit, sans égard pour la pluie qui pénétrait à flots dans la pièce. Il étouffa un juron et se précipita au-dehors. Je distinguai une colonne de fumée, au-delà du bosquet qui bornait le parc, en direction de la Croix Saint-Blaise, la plus grosse métairie du domaine. Je me précipitai à mon tour. Mon père ayant emprunté notre unique cheval, je dus courir jusqu’à la ferme. Fort opportunément, la pluie cessa : l’orage, ayant frappé, s’en allait porter ailleurs sa colère.
L’éclair avait crevé le toit de la grange, embrasé la moisson tout juste rentrée. Quand j’arrivai dans la cour, mon père dirigeait la lutte contre l’incendie. Derrière lui, le métayer Le Bihan et sa famille formaient une chaîne. Tout ce qui pouvait contenir de l’eau : seaux, seilles, écuelles même, était mobilisé. Cette tentative me parut dérisoire : que pouvaient quelques pintes de liquide contre la fureur d’un tel brasier ?
Par bonheur, la foudre avait épargné la maisonnette des Le Bihan. Mais la perte de la grange ne les éprouvait guère moins. Ils étaient trop démunis pour la reconstruire. Désormais il leur faudrait, comme leurs voisins, se contenter de couvrir les meules avec de la terre pour les protéger de la pluie. Mais au fait, quelles meules ? Une année de labeur partait en cendres. Voilà pourquoi ils s’acharnaient contre toute évidence, et mon père le premier. Il se tenait si près des flammes que la fumée, par moments, le dérobait à ma vue. Je pris place dans la chaîne. L’aîné des fils Le Bihan et l’une des brus puisaient l’eau avec tant d’énergie que les seaux volaient de main en main sans jamais s’arrêter. L’aïeul, tout perclus qu’il était, me passait le seau, que je donnais à mon tour au Taiseux, un garçon de mon âge qui avait été mon compagnon de jeux dans mon enfance. L’esprit épais, il ne parlait guère. De là venait son sobriquet ; nul ne semblait se souvenir de son vrai nom, Perig. On appréciait surtout son ardeur au travail, car le gaillard, taillé en hercule, valait un attelage. Ce soir, il fixait sur le brasier son regard buté, balançant son corps dans le geste régulier du faucheur, insensible au poids des seaux.
Je ne possédais pas sa vigueur : bientôt l’échine et les bras me firent mal. Je me demandais comment le grand-père supportait un effort aussi soutenu, avant de m’apercevoir que Katel, l’aînée de Perig, s’était interposée entre lui et moi.
L’incendie jetait un éclat roux sur ses cheveux dénoués. Elle avait passé à la hâte une jupe sur sa chemise. Tout en relayant les seaux qu’elle me tendait, j’observais avec un certain émoi ses bras nus, les rondeurs de sa poitrine que ses mouvements animaient. Sans être belle, elle savait se montrer plaisante quand l’envie lui prenait. Mais ce soir, son visage arborait une expression effrayante. Je ne m’étais jamais avisé de sa ressemblance avec Perig, sans doute parce que la gaîté qui ne la quittait jamais contrastait avec l’hébétude de son frère.
Les porcs s’affolaient dans leur enclos. Je discernais aussi des pleurs d’enfants. Et des cris : « Plus vite, plus vite ! » Ils paraissaient encourager les flammes à monter plus haut. Les bourrasques provoquées par l’incendie rabattaient sur nous une fumée irritante. « Plus vite les seaux ! » Des détonations dominaient le ronflement du brasier : les pièces de la charpente éclataient. « Plus vite ! » Était-ce bien la voix grave de mon père que j’entendais ? Au plus près de la grange en feu, il dirigeait les opérations. Mais le gendre Le Bihan ne pouvait accélérer davantage la remontée des seaux.
Soudain un mur céda. La bâtisse tout entière bascula et ce qui restait de la charpente s’écroula avec fracas en projetant une immense gerbe d’étincelles. La paille enflammée se répandit, vomie par le bâtiment effondré. Les paysans se figèrent. Quelques-uns laissèrent rouler leur seau à terre.
Le Bihan se précipita vers le brasier en hurlant : « Monsieur le marquis ! » Alarmé par la détresse de sa voix, je me ruai à mon tour, sans me soucier des flammèches qui dansaient autour de ma tête.
Mon père, coincé sous un madrier fumant, avait perdu connaissance. Je me jetai sur la poutre brûlante, la poussai de toutes mes forces, sans grand succès jusqu’à ce que le Taiseux vînt me prêter main-forte. À deux, nous la soulevâmes assez haut pour permettre à Le Bihan de dégager le blessé.
Il était méconnaissable, la peau du visage noircie, craquelée, sanguinolente. Il respirait encore ; si faible était son souffle, chaque inspiration lui arrachait un gémissement.
« Faut prévenir le recteur ! » décida Le Bihan.
Ces paroles sonnèrent comme un glas. Je me révoltai :
« Non, attends ! Ramenons-le à Kervadec. »
Le Bihan, se rappelant à temps nos conditions respectives, se retint de soulever une objection, mais ses yeux disaient assez ce que ses lèvres ne prononçaient pas.
« Comme vous voudrez, Monsieur Jean, soupira-t-il. Taiseux ! Attelle la charrette ! »
Tandis que Perig se dirigeait vers l’étable, Le Bihan trouva dans le dévouement que lui inspirait le père le courage d’insister auprès du fils :
« Sauf votre respect, Monsieur Jean. Ça n’empêche qu’on devrait appeler le recteur. »
Katel se proposa. Je ne la retins pas. Elle partit en courant, à demi dévêtue, en direction du presbytère.
« C’est pitié, murmura Le Bihan. Le Bon Dieu sait ce qu’il fait et on n’a rien à en redire, nous autres. Mais tout de même, c’est grande pitié. »
Pensait-il à mon père ou à la récolte qui achevait de se consumer dans les décombres de la grange ?
Pendant tout le trajet, je m’agrippai à la ridelle. Le grincement des roues sur les pierres du chemin, c’était, je le jure, le bruit sinistre du char de l’Ankou. Plus jamais je n’entendrai passer une charrette sans songer à cette funeste soirée.
Sitôt prévenu, l’abbé Milon accourut. Avec le viatique et l’huile consacrée, l’excellent homme avait emporté ce qu’il possédait de remèdes. Un peu médecin, comme le sont tous les prêtres, il prépara une décoction de pavot pour calmer la douleur du blessé. Il ne pouvait faire davantage. Jakez aussi s’était déclaré impuissant.
Prévenu par la rumeur publique, qui se propage à la vitesse de la flamme dans un fenil, M. Le Dantec arriva dès le lendemain de l’accident en compagnie de sa femme et de sa fille. Avec beaucoup de chaleur, il m’assura de sa compassion, tout en évoquant mon père dans des termes touchants. Je lui en sus gré. Je ne voyais d’autre motif à sa visite que son amitié pour le blessé, sans m’offusquer de sa hâte à en parler comme si celui-ci avait déjà rendu son âme à Dieu.
Maxime Le Dantec était un homme petit, replet, chauve, à la lèvre et aux joues pendantes, au nez proéminent, à l’œil porcin. Sa fille avait heureusement hérité des traits harmonieux et de la finesse d’esprit de sa mère. Elle comptait deux ans de plus que moi. En sa présence, je faisais généralement piètre figure. Ses yeux bleus, ses cheveux blonds dont les boucles encadraient l’ovale délicat de son visage tel un diadème, ses lèvres fines et mutines qui s’étiraient dans le plus charmant des sourires me troublaient au point de me rendre gauche. Je la connaissais pourtant depuis longtemps. Mon père et le sien étaient en affaires, comme on dit : cela signifiait qu’au fil des années M. Le Dantec avait acheté plusieurs parcelles du domaine, et non les moins bien placées. Sa fille l’accompagnait parfois dans ses visites. J’en venais à les souhaiter, sans considérer qu’elles représentaient l’érosion de nos biens.
Elle se nommait Maria. Est-il un prénom plus doux que celui-là ?
Dans ce jour où le malheur frappait Kervadec, sa présence m’était un baume précieux. M. Le Dantec me parlait de mon avenir, des difficultés que je rencontrerais à entretenir le domaine, des dettes de mon père qui grevaient mon futur héritage. J’observais Maria à la dérobée et je ne songeais pas à m’indigner de tels propos, pour le moins prématurés.
« Dans tous les cas, Monsieur Jean, dit-il en posant la main sur mon genou avec une familiarité qui ne me heurta même pas, je vous le dis tout rond. J’étais l’ami de votre père, je veux être le vôtre. Bon chien chasse de race, n’est-il pas vrai ? Nous nous entendrons toujours, vous pouvez compter sur moi. »
Et pour me prouver la sincérité de ses paroles, il revint le lendemain. Seul, hélas.
L’agonie de mon père dura trois jours. Le manoir ne désemplit pas. Les paysans se relayaient au chevet de leur maître. La plupart pénétraient pour la première fois dans ses appartements. La nudité des lieux les surprenait, les décevait peut-être. Ils n’imaginaient pas ainsi le « château », comme ils disaient en parlant de Kervadec. Mon père se réjouissait de les voir. Il se savait au terme de son existence ; cependant, les rares fois où il ouvrit la bouche, ce ne fut pas pour se plaindre mais pour s’inquiéter de la récolte et des dégâts provoqués par l’orage.
Sur le point de trépasser, il reçut l’onction des mains du P. Milon. Après le départ de celui-ci, il me dit : « C’est tout de même une bien curieuse superstition que penser qu’un peu d’huile sur le front facilite la grande glissade ! Comme si l’Être Suprême avait besoin de ces mômeries. Mais enfin, si ce brave recteur n’avait pas acquis la conviction de m’avoir arraché à l’enfer en me persuadant d’accepter son sacrement, il en aurait eu beaucoup de chagrin. »
Il me demanda aussi d’avertir ma tante, Mme de Rivelen. Le marquis, en effet, avait une sœur. Je ne la connaissais pas. À quinze ans, elle avait épousé un armateur brestois qui avait largement dépassé la quarantaine, M. Combray. Il n’entrait pas d’amour dans cette union. En récompense de vingt années au service de la Chambre des Comptes de Brest, le roi avait anobli ce prospère négociant, que le labeur de quatre générations avait hissé jusqu’à l’aisance. Au nom de Combray, le bourgeois ajouta celui, tombé en déshérence, de Rivelen. Mais il avait besoin de donner un peu de crédibilité à cette particule qui, pensait-il, favoriserait ses affaires. Louise de Kervadec était pauvre mais armoriée. Il la demanda. Elle avait de glorieux ancêtres mais ni rentes ni attrait pour le voile. Elle accepta. Mon père n’évoquait pas cet arrangement sans irritation. Car prôner l’égalité entre tous les hommes et vivre dans la simplicité ne l’empêchaient pas de condamner cette mésalliance.
J’attendis en vain qu’il me parlât de mon frère. Épuisé par l’effort qu’il venait de consentir en prononçant deux phrases, il se tut et ferma les yeux pour ne plus les rouvrir.
…
RDV vendredi prochain pour la suite.
Les éditions Argyll
 ">
">