La semaine passée, nous vous invitions à découvrir les premières pages de “Sous le Vent de la liberté“, le nouveau roman de Christian Léourier.
En voici la suite !
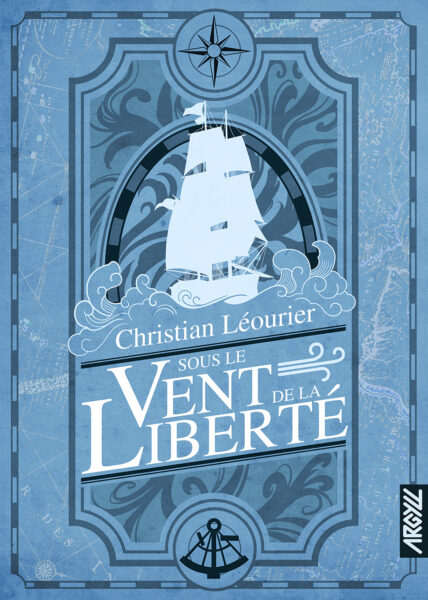
Chapitre 2
M. Combray de Rivelen
La pluie estompait les arbres du bosquet. Elle avait commencé l’avant-veille, à l’aube, au moment précis où mon père était mort au terme d’une nuit de souffrance. Depuis, les paysans défilaient en silence devant sa dépouille. D’aucuns pleuraient. Aimaient-ils cet homme qui s’était efforcé d’agir envers eux avec justice et compréhension, mais auquel ils versaient une part d’une récolte acquise à grand peine et tout juste suffisante pour couvrir les besoins de leur famille ? Sa mort leur rappelait-elle que le temps est inexorable, que rien n’est immuable, et qu’eux-mêmes un jour se présenteraient devant le tribunal de Dieu ? Melle, la vieille servante qui était entrée au service de notre famille alors qu’il était encore dans l’enfance, reniflait son chagrin. Jakez ne cessait d’aller et venir entre la chambre mortuaire et je ne sais quelle tâche. À genoux près du lit, le P. Milon priait, aussi pâle que le défunt.
Vers dix heures, un homme entra dans le salon d’honneur en secouant son manteau ruisselant. La noirceur de ses prunelles embusquées sous un sourcil charbonneux, ses lèvres remontées en une moue méprisante, deux rides verticales traversant ses joues durcissaient son visage. J’éprouvais immédiatement une vive antipathie pour ce personnage ; elle se mua en exaspération quand je le vis se comporter en maître avec les paysans qui encombraient la salle.
« Pourquoi n’allume-t-on pas de feu ? s’écria-t-il en se laissant tomber dans le fauteuil préféré de mon père. Avec cette pluie, il ferait bon se sécher ! »
Puis, se tournant vers moi, il m’écrasa d’un regard sans indulgence :
« Ainsi, voilà mon neveu, je suppose ! »
Je fis de cette façon la connaissance de M. Combray de Rivelen et compris aussitôt pourquoi mon père ne prisait guère l’époux de sa sœur.
Il observait la demeure avec le regard d’un huissier dressant un inventaire. À l’évidence, la rareté du mobilier le consternait. Il n’avait pas demandé à voir son beau-frère. Je dis, d’une voix aussi glaciale que possible :
« Monsieur, mon père sera bientôt mis en bière.
— J’ai entendu le glas, en arrivant. »
Il se radoucit soudain, mesurant sans doute combien son attitude pouvait me froisser.
« Beaucoup de choses nous séparaient, le marquis et moi, constata-t-il. J’ignore ce qu’il vous a raconté à mon sujet. »
Bien peu, à vrai dire. Je le savais négociant et armateur. Prospère et avare : il avait refusé d’investir des fonds dans les projets agricoles de mon père, ce qui autorisait ce dernier à mépriser celui qu’il appelait le barbon. Le lui révéler ne me parut cependant pas assez blessant. Je me tus, laissant par ce silence supposer davantage.
« Madame de Rivelen ne vous accompagne pas ?
— Son médecin recommande de lui éviter toute émotion afin de ménager ses nerfs, qu’elle a fragiles.
— Je comprends », dis-je en m’efforçant d’exprimer, par mon ton, que je n’étais pas dupe de cette excuse. Une Kervadec, fragile ? Impensable ! Il ignora ma froideur.
« Le marquis et moi n’avions pas les mêmes idées, Dieu merci. Votre pauvre père s’était laissé troubler la cervelle par la lecture des Physiocrates et autres gredins de cet acabit. J’espère qu’il ne vous a pas chamboulé l’esprit avec des turpitudes inspirées par le Démon ! »
Il quêta une approbation du côté de l’abbé, mais celui-ci tournait ostensiblement la tête dans une autre direction. S’il n’approuvait pas les opinions de mon père, il jugeait indécent qu’on les désavouât d’une manière injurieuse le jour même de ses obsèques.
« Enfin, il n’est pas trop tard, bougonna M. Combray. Vous êtes encore trop jeune pour être bien vicieux. Nous veillerons à vous donner une éducation de chrétien, fidèle à son roi et à l’église.
— Le P. Milon s’en est chargé ! » affirmai-je, me dressant de toute ma hauteur avec l’arrogance d’un jeune coq.
Il se leva, avec une agilité inattendue chez un homme dont l’aspect évoquait déjà le vieillard – et, de fait, il frisait la soixantaine. La fureur décomposait ses traits. Homme pressé, il ne supportait pas la contradiction. L’arrivée des Le Dantec endigua le flot de sa colère.
Maxime Le Dantec se précipita vers moi, m’attrapa les deux mains et les secoua en appuyant cette démonstration d’un regard où se lisait tout le chagrin du monde. Il avait les paupières rouges et les traits défaits.
Pendant ce temps, son épouse recevait les hommages de M. Combray et présentait ses respects au P. Milon. Elle se comportait déjà en châtelaine mais, de cela, je ne m’en avisai que plus tard. Quand son mari consentit enfin à me lâcher, elle se tourna vers moi.
« Maria voulait venir, dit-elle. Je le lui ai interdit. Cette petite est si sensible ! Mais croyez, Monsieur le Marquis, que j’ai dû discuter ferme et même un peu me fâcher pour l’en dissuader. »
C’était la deuxième fois qu’on me donnait du marquis : un paysan avait commis la même erreur, oubliant que le titre revenait à mon frère aîné. Cependant, je ne songeai pas à la reprendre. Elle avait prononcé le nom de Maria : mes idées s’embrouillaient et je devenais sot.
Le crissement des roues devant le seuil m’annonça le corbillard.
La famille avait comme il se doit sa chapelle dans l’enclos paroissial du village. Tous nos gens attendaient. Au passage du convoi, les hommes ôtaient leur chapeau et les femmes se signaient. Pendant l’office, mon oncle pria fort dévotement.
Devant la crypte dans laquelle descendait le cercueil, je mesurais combien le destin de notre famille était funeste. Je n’avais jamais connu mes grands-parents. Ma mère était morte en me donnant le jour. Je ne me souvenais pas d’avoir vu ensemble mon père et sa sœur. Et un océan me séparait d’un frère que je n’avais jamais embrassé.
À l’aube de ma quinzième année, je me retrouverais bientôt seul.
J’espérais voir M. Combray reprendre la route sitôt la cérémonie achevée. Il n’en fut rien. D’une façon plus surprenante, les Le Dantec s’attardèrent également à l’entrée du cimetière. M. Le Dantec et mon oncle tinrent ensemble un long conciliabule. De temps en temps, ils lorgnaient dans ma direction. Le Dantec détournait son regard quand il croisait le mien. Puis mon oncle m’invita à le rejoindre dans sa voiture pour regagner le manoir. Les sièges en étaient rembourrés et sentaient le cuir neuf.
Dans l’après-midi, le notaire arriva à Kervadec. Il montait une vieille jument blanche et cagneuse, dont le seul mérite était sans doute de ne pas avoir coûté cher à son acheteur. Maître Boldu connaissait bien le chemin qui menait au manoir : mon père avait eu recours à ses services pour vendre maintes parcelles du domaine. Tant que cet homme au teint hâve, vêtu été comme hiver d’un manteau à la mode d’Angleterre, traversait la cour, le chien tirait sur sa chaîne en vociférant. Je m’en défiais également, par instinct plus que par raison, car, n’ayant jamais assisté à l’un de ses entretiens avec mon père – dans ces occasions, celui-ci s’arrangeait toujours pour m’éloigner –, je n’avais pas lieu de le croire plus malhonnête qu’il n’est d’usage dans sa charge. Mais tout me déplaisait dans ses manières à la fois obséquieuses et suffisantes. Je trouvais grossier qu’il se présentât aussi tôt pour régler la succession. Je m’apprêtais à lui exprimer ma façon de penser, mais il m’ignora, réservant sa déférence exagérée à M. Combray. Je m’approchai. Non seulement mon oncle ne me chassa pas, mais il m’accueillit avec un sourire, si on peut appeler ainsi l’étirement de ses lèvres qui réduisait sa bouche à une simple fente.
« Maître Boldu avait la confiance de votre père. Il saura mettre de l’ordre dans ses affaires. Vous êtes mineur. Notre parenté me désigne comme votre tuteur. D’ailleurs, je suis votre seule famille. Vous préparerez votre bagage. Si j’en juge par ce que je vois, il sera tôt fait.
— Mon bagage ? m’étonnai-je.
— Je vous emmène à Brest. Votre tante a beaucoup insisté sur ce point. »
Je me raidis :
« Je vous sais gré, mon oncle, du souci que vous prenez de moi. Mais si, à quinze ans, on est mineur, on n’est plus un enfant et j’entends demeurer à Kervadec. D’ailleurs, il n’est pas exact que vous soyez ma seule famille : j’ai un frère.
— Certes, je n’aurais garde de l’oublier, approuva-t-il avec un empressement suspect. Et je vais m’efforcer de l’informer du décès de son père. Mais cela ne sera pas aisé. Depuis combien d’années n’a-t-il pas donné signe de vie ? »
Je le trouvais fort bien renseigné, pour un homme que nous ne fréquentions pas.
« Les Amériques ne sont pas sûres, poursuivit-il. Pleines de sauvages, de marécages où l’on attrape la fièvre. Sans parler de l’océan et des Anglais. S’il revient jamais, nous aviserons. D’ici là…
— Je l’attendrai ici ! »
Il soupira, jeta vers le notaire un regard où se lisait l’accablement. J’avais déjà vu cette expression désolée sur les traits de Le Bihan quand, après avoir cassé son bâton sur le dos de son âne, il constatait que l’animal n’avait pas progressé d’un pouce.
« On dirait, mon enfant, que vous ignorez dans quelle déconfiture se trouve votre bien. Au lieu d’étudier les théories fumeuses des économistes et d’engloutir les restes de son capital dans je ne sais quel mirage agricole, votre pauvre père eût été mieux avisé de gérer ses affaires avec plus de discernement. En prenant des parts dans mon négoce, par exemple. Je le lui avais proposé. Il a préféré entamer son capital et dépecer le domaine que lui laissaient ses ancêtres. Les rares parcelles qui n’ont pas été vendues sont aujourd’hui couvertes d’hypothèques, tout comme le logis. Je ne saurais me mettre en charge de ces dettes. Fort heureusement, le principal créancier a la bonne grâce, en attendant le règlement de la succession, de ne pas exiger le remboursement immédiat de traites échues depuis longtemps. À condition, bien entendu, de jouir sans délais de ses droits. En particulier du manoir.
— Le principal créancier ?
— Monsieur Le Dantec. »
Ce coup m’anéantit. Je me laissai choir sur une chaise, la poitrine oppressée. Pendant ce temps, le notaire sortait d’une sacoche de cuir aussi usée que sa redingote un acte auquel il ne manquait plus que la signature de mon tuteur. Celle de Le Dantec y figurait déjà. Maître Boldu plongea de nouveau la main dans son nécessaire, pour en extraire une plume et un minuscule encrier d’argent. La plume grinça, sinistre, quand mon oncle apposa son paraphe au pied du document.
« Voilà qui est réglé, dit-il. Préparez-vous. Nous devons arriver avant la retraite. »
À peine toucha-t-il au repas qu’avait préparé Melle : il était trop pressé. Je ne fis pas davantage honneur aux talents de la vieille cuisinière, mais pour une autre raison : j’avais la gorge trop nouée pour avaler le moindre morceau.
Je redoutais de quitter Melle. À juste titre. La pauvre femme m’avait élevé. Mon départ lui brisait le cœur. Elle s’accrocha à moi, m’inonda de ses pleurs.
« Je reviendrai bientôt », soufflai-je à son oreille, bien persuadé de tenir ma promesse.
Cela n’étancha pas ses larmes. Son époux, Jakez, se laissait lui aussi aller à pleurer. Je me devais de montrer l’exemple de la fermeté. Je n’y parvins qu’en m’astreignant au silence. Au premier mot, j’aurais à mon tour éclaté en sanglots.
Sur le perron, je tombai sur Le Bihan. Il portait encore sa tenue du dimanche, revêtue pour les obsèques. Ses doigts courts tripotaient les rubans de son chapeau.
« Sauf votre respect, Monsieur Jean. On dit que le nouveau propriétaire est riche. Croyez-vous qu’il reconstruira ma grange ? »
Les nouvelles couraient vite, sur la lande !
« Que me chantes-tu, avec ton nouveau propriétaire ? le rabrouai-je. Jusqu’à preuve du contraire, Kervadec appartient aux Kervadec ! »
Je lui en voulais, injustement sans doute, d’oublier en quelles circonstances son maître avait trouvé la mort.
« Eh bien, venez-vous ? » s’impatientait mon oncle, depuis sa voiture, tandis que son cocher chargeait mon maigre bagage.
Je gardai les yeux fixés sur le chemin, droit devant moi, tandis que dans mon dos s’éloignait la lourde bâtisse de granit.
« Nous arrêterons-nous au village, mon oncle ? J’aimerais prendre congé du P. Milon. »
Cela le contrariait. Il ne pardonnait pas à mon précepteur de ne pas l’avoir soutenu. Mais, par respect envers sa soutane, il n’osa pas me refuser ce que je lui demandais. Hélas, l’abbé n’était pas dans sa cure. Je lui laissai un message, désespéré de ne pouvoir lui confier mon désarroi. Lui seul aurait su me conseiller d’une manière à la fois avisée et désintéressée. Car les autres, j’en étais convaincu, avaient conspiré pour me dépouiller. Tout s’était passé si vite : comment douter que mon oncle et Le Dantec se fussent depuis longtemps concertés ? Mon frère au diable Vauvert, moi mineur, Le Dantec pouvait impunément se pavaner à Kervadec si Combray l’y autorisait. Combien ce dernier touchait-il pour cette trahison ? Tandis que la voiture cahotait sur la lande, je savourais l’amertume d’imaginer une vengeance qui emporterait dans une même tourmente les deux complices.
Cela ne m’empêchait pas de me sentir le cœur vague en songeant aux yeux de Maria. Pour moi, aucun doute : on l’avait tenue à l’écart de la machination dirigée contre mes intérêts. Sinon, elle l’aurait dénoncée.
Mais quand la reverrais-je ?
…
Pour précommander le livre c’est ICI.
RDV vendredi prochain pour le chapitre 3 !
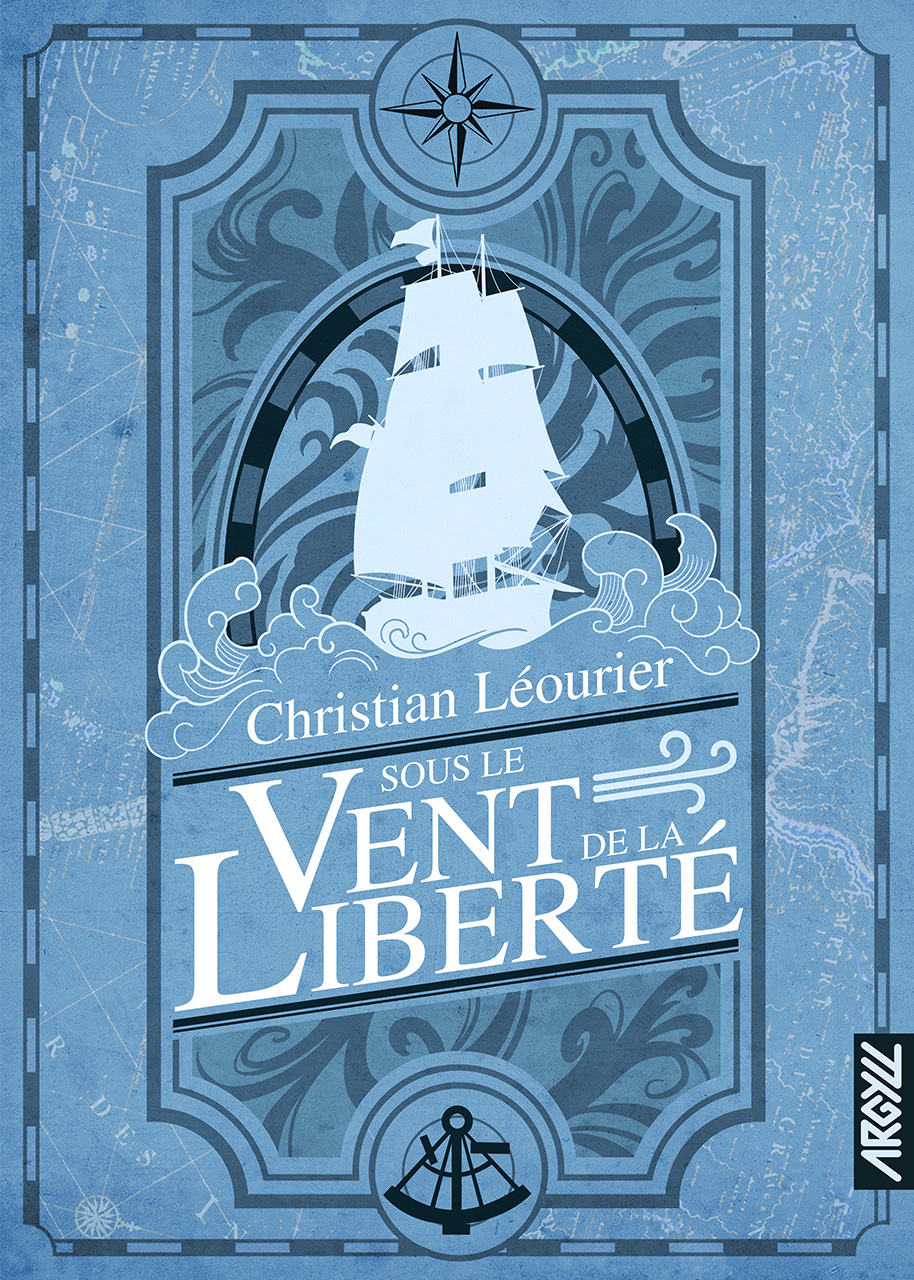 ">
">