Vous commencez maintenant à être habitués. Avant le week-end, nous vous proposons un nouveau chapitre du prochain roman de Christian Léourier, “Sous le Vent de la liberté“, à la façon de certains grands classiques du roman historique publiés sous forme épisodiques.
Place au chapitre 3, où notre héros découvre la ville…
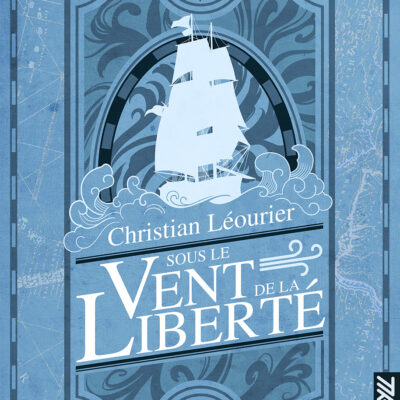
Chapitre 3
Les nouveaux maîtres
Brest !
Dans nos campagnes, on ne prononçait pas ce nom sans réticence – ou une secrète envie. Aux oreilles de nos pieux paroissiens, il sonnait comme Sodome ou Gomorrhe : une cité de débauche, dans les rues de laquelle le diable emportait dans sa ronde soldats et filles perdues. Aussi, elle était trop près de l’océan. Pour un paysan de la lande, la mer, c’est la mort. Pour ma part, malgré le désagrément que j’éprouvais à voyager au côté de mon sévère parent, je sentais l’excitation monter en moi à l’approche de la ville. Bien qu’elle se trouvât à une demi-journée à peine de Kervadec, je n’y avais encore jamais mis les pieds.
De ce côté-ci de la rivière Penfeld, une seule porte perçait le rempart. On la fermait le soir, et c’est pourquoi mon oncle était aussi pressé de l’atteindre. Quoique la Grande Rue fût large, comparée aux boyaux qui débouchaient sur elle, la voiture progressait avec peine à cause de son encombrement. Le cri des charretiers, le hennissement des mules, le trot des chevaux montés par les dragons de la garnison, la foule des paysans venus vendre aux gens de la ville, qui un panier de légumes, qui une poule encore caquetante, se mêlaient dans un vacarme étourdissant. Plus de vingt-mille habitants, sans compter les soldats en attente d’embarquement, s’entassaient dans l’espace exigu cerné par son enceinte. Moi qui n’aimais rien tant que les longues chevauchées dans la lande déserte, je contemplais cette bousculade avec un ahurissement incrédule, un peu craintif.
Pour affirmer aux yeux de tous la prospérité de son commerce, M. Combray avait fait bâtir un hôtel dans le quartier du Champ de Bataille, où logeait l’aristocratie de la ville. Cependant, négligeant de m’y déposer, il donna l’ordre au cocher de poursuivre jusqu’au port. Le spectacle des navires encombrant l’embouchure de la Penfeld me transporta d’enthousiasme. Enfin, je les voyais de mes yeux, ces bâtiments que j’avais si souvent imaginés, plus énormes que dans mes rêves les plus fous ! Et combien nombreux ! Une forêt de mâts se dressait, plus haute que le clocher de mon village, sur chaque rive. Il flottait sur elle une odeur nouvelle pour moi : les effluves de l’océan, le remugle du goudron fondu par les calfats, la fumée des braseros où les ferronniers mettaient à rougir leurs instruments. Je l’avoue : cette puanteur me séduisit aussitôt. Peut-être parce qu’elle se mélangeait aux parfums délicieux échappés des ballots qui, déchargés par une armée de portefaix, s’entassaient sur les quais. Les matelots s’interpellaient. Des coups de sifflet ponctuaient les manœuvres. Partout résonnaient le fracas des masses, le grincement des poulies, les aboiements des gradés. De l’arsenal provenait une rumeur incessante qui témoignait d’une activité intense. Les goélands lançaient en volant leur cri geignard. Malgré tout, on finissait par distinguer un autre bruit, plus subtil, le battement de cœur de cette ville : le clapotis des vagues frappant les coques.
La voiture s’arrêta sur le quai marchand, devant l’ancien domicile de la famille Combray, là où tout avait commencé. Un office en occupait le rez-de-chaussée. Le silence affairé qui régnait en ce lieu offrait un saisissant contraste avec le tumulte de l’extérieur. Des greffiers plantés derrière de hauts pupitres se penchaient sur de lourds registres. Je savais le négoce de mon oncle florissant – un simple regard sur la voiture et la livrée de son cocher m’avait édifié sur ce point. Mais à voir tous ses commis aligner des colonnes de chiffres, je mesurai à quel prix Louise de Kervadec avait vendu ses quartiers de noblesse.
Des registres reliés de toile noire ou bleue couvraient tous les murs de l’étude. Seule décoration de ce temple tout entier consacré au commerce, le modèle en réduction d’un voilier trônait en son centre. Rien n’y manquait. La moindre manœuvre, le plus petit taquet étaient reproduits. Les voiles étaient carguées sous leurs vergues, sans doute pour permettre de distinguer le détail des mâts et des haubans. La figure de proue représentait une femme les bras croisés sur la poitrine. Mon oncle remarqua la fascination qu’exerçait sur moi ce chef-d’œuvre.
« La Belle-Louise », claironna-t-il avec orgueil.
Par galanterie, il avait donné au fleuron de sa flotte le nom de son épouse. Néanmoins sa première visite, au retour de son voyage, avait été pour son office.
Une détonation me fit sursauter. Ce coup de canon, qui annonçait aux ouvriers de l’arsenal la fin de leur journée de travail, libérait aussi les commis de M. Combray. Lui-même resta à compulser les comptes et rédiger diverses correspondances pendant deux heures, avant de s’arracher à ses livres. Il me paraissait transformé. La crispation de ses traits, qui lui donnait l’air d’être toujours un peu en colère, avait disparu. Tandis que la voiture se dirigeait vers l’hôtel de Rivelen, il prit la peine de me dévoiler l’étendue de ses affaires. À Brest, où la priorité revenait à la flotte militaire, il importait du vin de Bordeaux, des matériaux de construction et de la toile, à l’instar de ses prédécesseurs. Cependant M. Combray ne s’était pas contenté de succéder à ses aïeux. Il nourrissait bien d’autres ambitions et entendait développer le négoce qu’ils lui avaient légué. Pour commencer, la guerre d’Amérique lui ouvrait un débouché dont il attendait beaucoup. Ses navires acheminaient de l’autre côté de l’Atlantique de la poudre et des munitions ; ils revenaient les cales garnies de sucre, de café et de tabac de Virginie dont il tirait un grand bénéfice. Cela lui donnait des idées. Le commerce aux îles n’étant pas autorisé dans un port militaire, il avait pris des attaches à Nantes. Conscient qu’il se heurterait aux Antilles à une concurrence sévère et bien installée, il envisageait des mers plus lointaines, pour des profits plus conséquents. La Belle-Louise, tout juste sortie des formes, les lui promettait.
Sur l’expression de cette espérance, nous pénétrâmes dans la cour de l’hôtel de Rivelen. Les décorations de la façade restaient discrètes. La pluie n’avait pas eu le temps d’en ternir la pierre. Un valet en livrée nous attendait sur le perron. Sur instruction de son maître, il s’en fut prévenir Mme de Rivelen de notre arrivée.
Depuis ma naissance, ma tante n’était jamais venue à Kervadec et les rares fois où mon père en parlait, il évoquait une petite fille. Je me retrouvai face à une femme strictement vêtue de noir, l’œil scrutateur, encore jeune, certes, mais qui serait bientôt sèche. Je la saluai. Comparée à son accueil, la conversation de son mari avait été un modèle de cordialité. Après m’avoir examiné de bas en haut, elle soupira, à l’intention de son époux :
« Mon pauvre ami, que voilà un fier parent ! Il faut au plus tôt lui faire tailler un habit décent. Ah ! vraiment, mon frère a été bien inspiré de mourir si tôt ! »
Piqué au vif, je répliquai :
« Je comprends, Madame, que la simplicité de ma mise jure avec le raffinement de cet hôtel. Cependant, il aurait été fort simple d’éviter ce problème en me laissant la jouissance de mon domaine. Ainsi je n’aurais pas été à votre charge, ni n’aurais détonné dans votre salon. »
Elle sursauta, offusquée. Imaginait-elle que je venais chez elle pétri de reconnaissance et d’humilité ?
« La bonne idée, en vérité ! s’exclama-t-elle, tandis qu’un soupçon de rougeur lui montait aux joues. Quand bien même vos créanciers ne vous eussent pas sauté à la gorge, qui aurait pourvu aux intérêts des emprunts ? Au reste, ici comme ailleurs, il ne convient pas qu’un Kervadec passe pour un gueux. Il suffisait bien de mon pauvre frère, que sa marotte a conduit à tâter de la charrue et dont on fait jusqu’ici des gorges chaudes ! Paix à son âme », ajouta-t-elle en dessinant un rapide signe de croix.
Je soupçonnais mes parents d’avoir agi par intérêt. Ma tante me dévoilait un autre motif, au moins aussi puissant : en m’éloignant de Kervadec, elle espérait mettre une sourdine au scandale qu’avait suscité le comportement de son dernier occupant. Son époux, naturellement moins attaché à la respectabilité de mon nom, tenta de la modérer en arguant qu’il ne convenait pas d’engager de gros frais pour la toilette d’un futur séminariste.
À ce mot, la terre se déroba sous mes pieds. Quoi ! Non content de m’arracher à Kervadec, ce bourgeois entendait faire de moi un prêtre ! Il était aisé de comprendre pourquoi : en entrant dans les ordres, je renoncerais à mes biens, le mettant ainsi à l’abri de toute réclamation.
Mais s’il croyait manœuvrer un Kervadec par un procédé aussi grossier, il courait au devant d’une grande déception !
Cette nuit-là, je ne pus trouver le sommeil, l’esprit torturé par une multitude de projets plus irréalisables les uns que les autres. Au matin, ma décision était prise. Tous les cadets de Bretagne, même s’ils ne sont pas très versés dans les arcanes de la loi, savent que seul l’aîné, celui-là même qui hérite du titre, du domaine et des archives familiales, peut saisir la justice du roi en matière de succession. Si je voulais chasser Le Dantec du manoir et dénoncer les abus de mon oncle, il me fallait provoquer le retour d’Yves au plus tôt.
Un peu avant l’aube, je me glissai dans l’écurie. Avec mille précautions, je sellai un cheval. Je franchis le porche en le tirant par la bride, inquiet d’entendre le portier donner l’alerte. Mais, soit qu’il dormît encore, soit qu’il ne se défiât pas du neveu de son maître, il ne se manifesta pas. Malgré l’heure matinale, la rue menant à la porte de Landerneau était encombrée. À mon grand dam, j’avançais au pas, craignant d’entendre dans mon dos retentir les cris de domestiques lancés à ma poursuite. Sitôt passé le rempart, je pris le galop. Le trajet de Kervadec à Brest m’avait paru interminable quand je l’avais parcouru au côté de mon oncle. En sens inverse, il me sembla plus court. Craignant que, mon forfait découvert, M. Combray ne lançât ses gens à ma poursuite, je ne m’autorisai aucun arrêt, au risque de crever le cheval sous moi. Ma monture, un alezan brûlé, habitué à l’attelage, n’était pas un coursier de premier ordre. Néanmoins cette escapade lui offrait l’occasion d’exprimer sa nature généreuse et la pauvre bête supporta sans broncher le train d’enfer que je lui imposai.
Au terme d’une galopade entrecoupée de courtes périodes de trot pour ménager l’animal, j’aperçus la silhouette familière de notre clocher. Un chien aboya quand j’abordai le village ; son appel fut repris de niche en niche. Je me précipitai le cœur battant vers le presbytère. Le verrou n’était pas tiré : le P. Milon ne fermait jamais sa porte. Nous restâmes enlacés un long moment. Il paraissait aussi ému de me revoir que je l’étais moi-même, comme si nous nous étions quittés depuis une éternité. Je crois que nous versâmes quelques larmes.
Je lui racontai l’accueil que m’avait réservé ma parentèle et les projets qu’elle avait conçus.
« Le séminaire ? Trouves-tu donc si terrible de revêtir la soutane ? me taquina l’abbé. Tu ferais, ma foi, un élégant recteur. Mais ce serait un bien mauvais tour à jouer à ton libre-penseur de père.
— Dites-moi que faire ! l’implorai-je.
— Tout vient à point à qui sait attendre, énonça-t-il, usant d’un de ces proverbes dont il ne se montrait jamais avare. Entrer au séminaire ne signifie pas prononcer ses vœux. Patiente. Au moins, tu en sortiras instruit.
— Mais que m’y apprendra-t-on, que vous ne m’ayez déjà enseigné ? »
L’abbé secoua la tête en souriant avec indulgence.
« Yann, dit-il en employant mon prénom breton, celui de l’affection, tu cherches à me flatter, ce n’est pas bien. Tu sais pourtant que tu n’as pas besoin de cela pour obtenir mon aide.
— Pourquoi ne pouvais-je rester au manoir ?
— Tu poses une question dont tu connais la réponse : tu es mineur. En l’absence de ton frère aîné, c’est à ton plus proche parent, c’est-à-dire ton oncle, qu’il revient de gérer tes biens. Ton frère et toi héritez du domaine. Mais ton père avait contracté de gros emprunts…
— Je sais cela. Nous rembourserons.
— Avec quoi ? M. Combray n’a pas menti : Kervadec est couvert d’hypothèques. Ton père me l’avait avoué. Il comptait sur le succès de ses travaux agronomiques pour restaurer la fortune familiale. Mais à présent… Tu sais ce que cela signifie : si vous ne pouvez rembourser, le domaine sera vendu.
— Le pourceau Le Dantec s’est acoquiné avec le corbeau brestois ! Entre bourgeois…
— Ne sois pas aussi sévère. J’ai parlé à Maître Boldu. Le Dantec a la jouissance de Kervadec, mais il n’en a pas acquis la propriété. Pas encore. Grâce à cet arrangement, ton oncle a gagné du temps et empêché que ce qui reste de vos terres soit dépecé. Ces deux hommes que tu voues aux gémonies se sont montrés d’une grande prudence et d’une grande modération. »
Le P. Milon aurait trouvé des excuses au Démon lui-même ! Je lui en voulais, ainsi qu’à mon père, de m’avoir caché la vérité sur l’état de notre fortune. Je nous croyais pauvres. Nous étions ruinés. J’osai lui en faire grief.
« Tu as raison, reconnut-il. Le marquis pensait que tu aurais bien le temps de t’écorcher les doigts aux épines de la vie et moi-même… Mais plaie d’argent n’est pas mortelle. Bonne réputation vaut mieux que ceinture dorée… »
J’interrompis cette litanie de proverbes :
« Je ne suis pas sûr de la validité de l’accord conclu entre Le Dantec et mon oncle. Le notaire n’avait-il pas le devoir de consulter mon frère avant de disposer ainsi d’un bien qui lui revient par droit d’aînesse ? »
L’abbé enfouit son maigre visage dans des mains non moins décharnées et se frotta deux ou trois fois les joues : un geste qui lui était familier quand une question l’embarrassait. Cette fois, pourtant, il ne pourrait pas l’esquiver en invoquant la Providence, comme il avait coutume de le faire chaque fois qu’il se trouvait réduit à quia par les raisonnements logiques de mon père.
« Comment te répondre ? Je ne suis pas juriste. Ton frère ne donne plus signe de vie depuis longtemps. Et quand bien même : il est si loin, dans les Îles ou en Amérique. Alors, à moins d’aller le chercher… »
Il ignorait, mon brave précepteur, qu’en prononçant ces mots il scellait mon destin. Mais peut-être n’y était-il pour rien. Peut-être tout s’était-il joué à l’instant où j’avais respiré l’enivrante odeur de l’océan.
« Crois-moi, Jean, il est des circonstances où il faut s’abandonner à la Providence.
— Deum sequere ?
— Il y a pire mentor que Sénèque. Et oui, quand le choix de sa conduite n’est pas guidé par le devoir, il n’est pas absurde de suivre le chemin que Dieu nous trace et d’accepter le cours des choses. »
Il se trompait en pensant que je ne savais quel parti prendre. Et il aurait été surpris d’apprendre que le dieu de Cicéron, à défaut de celui de la Bible, venait de s’exprimer par sa bouche. « À moins d’aller le chercher… » avait-il dit. Eh bien soit, j’irai !
Je passai la nuit chez mon bon maître. Il insista pour me céder son lit et je pus constater que la réputation d’austérité que lui valait sa maigreur se justifiait aussi par la minceur de sa paillasse. Je dormis peu, l’esprit enfiévré par des projets dont je voulais ignorer le caractère fantasque, puisque je n’avais pas d’autre choix.
Le lendemain, après m’avoir offert une bolée de lait, il m’annonça qu’il intercèderait auprès de M. Combray pour que celui-ci pardonne ma fugue – et l’emprunt indélicat de son cheval –, mais qu’il me fallait, dans mon intérêt, regagner Brest. Je capitulai d’autant plus volontiers que je souhaitais désormais rejoindre le port. Pour un motif, certes, tout autre que le sien, mais je me gardai de le lui avouer. Je pense qu’il soupçonna quelque chose, car je ne l’avais pas habitué à une telle docilité. Cependant, il feignit de me croire.
Au moment de partir, je persuadai le P. Milon de la nécessité de me rendre une dernière fois au manoir pour récupérer quelques documents : cela justifierait, prétendis-je, mon escapade aux yeux de M. Combray. Si l’abbé trouva l’excuse oiseuse, il me laissa aller, sur la promesse de revenir bientôt.
Quand je m’engageai dans l’allée qui menait au manoir, le chien accourut en gambadant, en dépit de son grand âge. Jakez manifesta en me voyant une surprise heureuse qui m’alla droit au cœur.
« Monsieur Jean ! Je savais que vous reviendriez !
— Hélas, mon bon Jakez, je ne reste pas. »
Je lui expliquai le motif de ma visite. Ses traits s’affaissèrent.
« Alors, si vous devez repartir tantôt, il ne faut pas que Melle vous voie. Cela lui crèverait le cœur une fois encore. »
Comme je me dirigeai vers le perron, il m’arrêta.
« Les nouveaux maîtres sont là. »
Dans leur impatience de jouer les châtelains, les Le Dantec n’avaient même pas attendu l’arrivée de leurs meubles pour s’installer.
« Puisqu’il en est ainsi, annonce-moi. Eh bien ? Qu’attends-tu ? »
Le pauvre vieux obéit ; il n’aurait pas eu le dos plus voûté pour monter au gibet. J’observai la façade familière comme je ne l’avais jamais regardée. Et mon cœur battit un peu plus vite, car, derrière une croisée de l’étage, je venais d’apercevoir Maria. Elle leva la main pour m’adresser un signe timide. M. Le Dantec déboucha sur le perron.
Il souriait, mais son œil restait froid.
« Je vous croyais à Brest…, commença-t-il, mi-figue mi-raisin.
— Dans la précipitation du départ, j’ai omis d’emporter des papiers auxquels je tiens beaucoup. Les lettres de mon frère. Mon père les conservait dans une cassette entreposée dans la bibliothèque. Peut-être les avez-vous trouvées ? »
M. Le Dantec se troubla.
« Effectivement, bafouilla-t-il, sans avoir eu l’intention de surprendre des secrets de famille, j’ai ouvert par mégarde un coffret contenant quelques feuillets… M. Combray m’est témoin que je n’en ai rien distrait… »
Le Dantec me précéda dans la bibliothèque. La vue de ce sanctuaire raviva mon dépit et ma colère. Un jour, je reviendrais, je ferais rendre gorge à mes parents félons et à ce bourgeois qui, feignant l’amitié, avait si bien œuvré à me dépouiller ! Qui aurait tout aussi bien dépouillé mon père si celui-ci avait vécu quelques mois de plus !
La cassette de marqueterie trônait à sa place. Le Dantec n’avait pas éprouvé les scrupules qui m’avaient toujours retenu : il avait forcé la serrure, m’épargnant d’avoir à commettre ce sacrilège. Le coffret contenait de nombreuses lettres de libraires. Au fond, je découvris ce que je cherchais.
Avant de quitter la pièce, je laissai une dernière fois mon regard glisser sur les reliures. Le Dantec n’ouvrirait sans doute jamais aucun de ces livres. Je fondai l’espoir qu’au moins, il ne démembrerait pas la collection. Que, ces ouvrages faisant désormais partie de sa richesse, ils constitueraient une curiosité dont il se plairait à faire étalage comme d’autres montrent les œufs d’autruche ou les galuchats de leur cabinet d’histoire naturelle. Et que je retrouverais cette bibliothèque intacte quand je rentrerais en possession de mes biens. Ne pouvant en avoir la certitude, je ne résistai pas à la tentation de dérober un des livres préférés de mon père : les Lettres philosophiques de Voltaire. Je le dissimulai sous ma chemise, avant de rejoindre Le Dantec, la correspondance de mon frère à la main.
Le bourgeois eût été mieux inspiré de la détruire ! Mais sans doute s’était-il borné à parcourir les premières missives et jugé que cette correspondance entre le marquis et ses fournisseurs ne présentait aucun intérêt, ni aucun danger pour lui. J’exhibais l’arme de ma vengeance sous le nez de ma future victime et elle me souriait, inconsciente. Cela me procura un tel sentiment d’invulnérabilité que j’osai demander :
« N’aurai-je pas le plaisir de présenter mes hommages à Madame Le Dantec et à Mademoiselle votre fille ? »
Le visage de mon hôte se ferma.
« Ma fille n’est pas ici ! » répliqua-t-il.
Or, à ce moment, une porte s’ouvrit derrière moi. Le Dantec sursauta. Je me retournai.
Maria !
Elle était très pâle, raide, les lèvres serrées, comme si elle cherchait à maîtriser la plus vive émotion. Mais dans ses yeux, ses yeux si bleus, je vis l’éclat de l’acier.
« Maria… », commença Le Dantec.
Elle le coupa, s’adressant à moi :
« Il paraît, Monsieur, que vous nous quittez ?
— Provisoirement, croyez-le !
— Je l’espère, murmura-t-elle. Vous serez toujours le bienvenu pour moi. »
Dans mon dos, j’entendais la respiration de Le Dantec s’accélérer au rythme de sa colère. Je ne résistai pas à la tentation de l’attiser encore, par un madrigal pourtant maladroit :
« Vos paroles, Mademoiselle, me sont douces, parce qu’elles sont prononcées à un moment où le monde me paraît hostile et, surtout, parce qu’elles sont prononcées par vous. »
Ah ! Comme j’aurais voulu à cet instant avoir l’esprit d’un Fontenelle, au lieu de bredouiller une telle platitude. Cependant, Maria se montra indulgente. Elle m’adressa un sourire timide. Si éphémère qu’il fût, il valait à mes yeux toutes les promesses.
« Sachez, dit-elle, que je serai à Kervadec quand vous y reviendrez.
— Ma fille ! explosa Le Dantec. Vous perdez le sens ! Est-ce qu’une personne honnête parle ainsi ? Je vous prie de sortir immédiatement. »
Elle obéit, non sans une lenteur étudiée.
« Quant à vous, Monsieur, ajouta le père indigné lorsque je me tournai vers lui, déguerpissez ! Vous n’avez plus rien à faire ici ! Plus rien, m’entendez-vous ! »
Ses petits yeux porcins luisaient de haine. Je compris qu’il avait peur de moi ! Je le saluai d’un éclat de rire.
Je riais encore quand je sautai sur le dos du cheval que Jakez, prévoyant la brièveté de l’entrevue, tenait par la bride à l’endroit où je l’avais laissé. Piquant des deux, je m’élançai sur le chemin, criant le nom, le doux nom de Maria. Je me répétais ses paroles. Depuis la première fois où je l’avais vue, alors que nous étions tous deux des enfants, elle exerçait sur moi une véritable fascination. Au gré de ses trop rares visites à Kervadec, je l’avais vue se transformer, pour devenir plus charmante d’année en année. Je me serais damné pour un seul de ses regards clairs, qui ne paraissaient faits que pour souligner la beauté du monde. Son image me hantait. L’incoercible timidité qui s’emparait de moi en sa présence m’avait interdit de jamais lui en formuler l’aveu. Elle avait été, je le découvrais avec bonheur, assez fine pour le deviner. En n’hésitant pas à défier l’autorité paternelle, elle m’avait informé qu’elle n’était pas insensible à mes sentiments. Qu’elle les partageait !
J’étais désormais invincible !
…
C’est déjà fini. RDV la semaine prochaine pour l’avant-dernier épisode de notre feuilleton de l’automne !
Les éditions Argyll
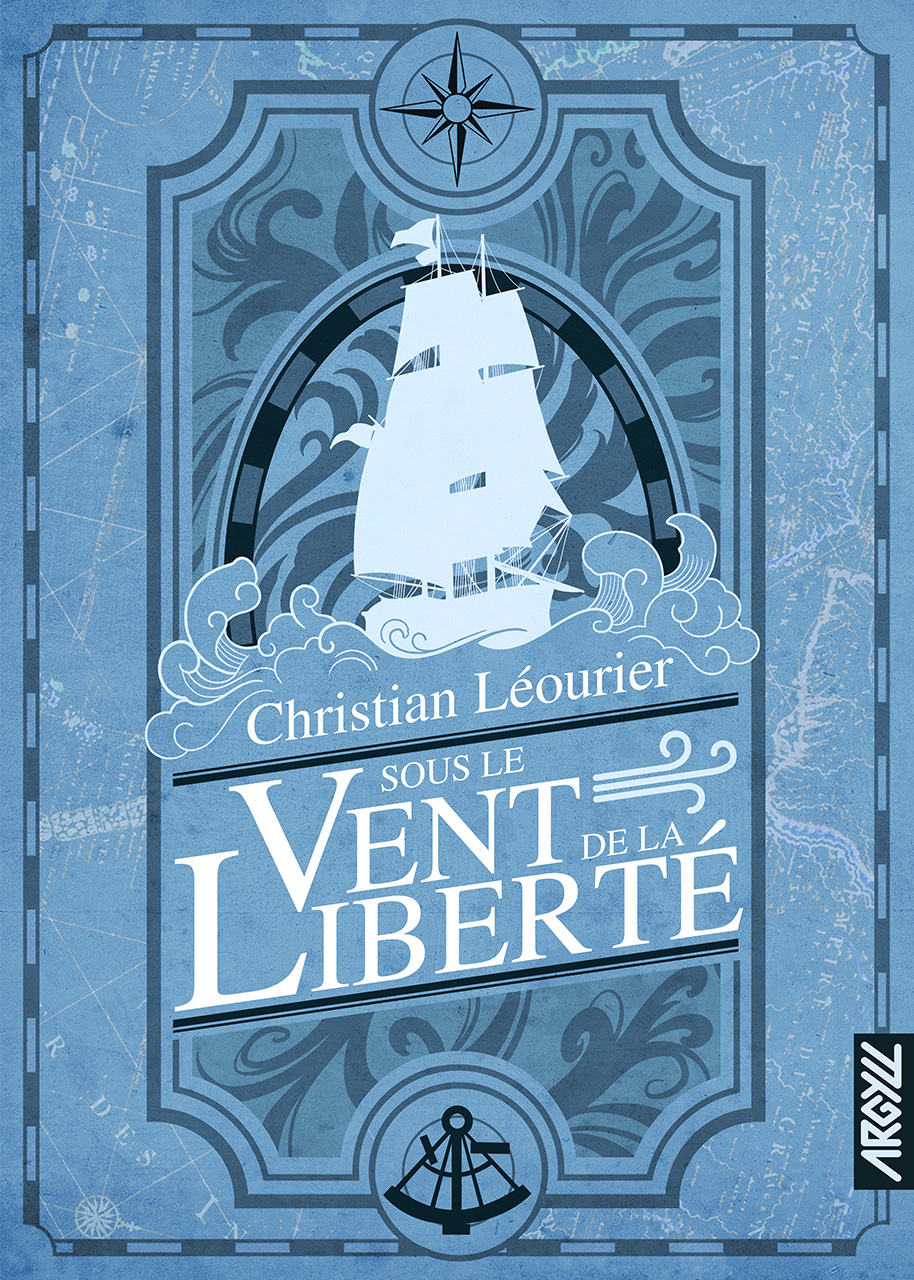 ">
">