Le vent fera craquer les branches
La brume viendra dans sa robe blanche
Y’aura des feuilles partout
Couchées sur les cailloux
Octobre tiendra sa revanche
Alors que Francis Cabrel chante le mois d’octobre, voici le quatrième chapitre de “Sous le Vent de la liberté“, dont les pré-commandes se terminent ce dimanche.
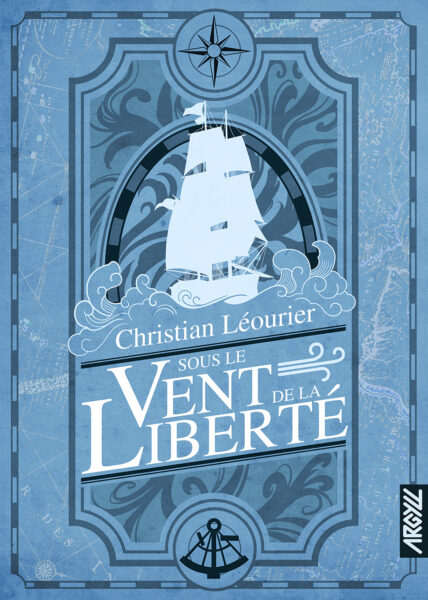
Chapitre 4
Un gabier surnommé Papegai
À mesure que nous approchions de notre destination, je redoutais davantage le courroux de mon oncle. Monté sur une vieille mule, le P. Milon ralentissait l’allure ; tant et si bien que, nous heurtant à la porte close de la cité, nous dûmes recourir à l’hospitalité d’un curé des environs. Celui-ci nous l’accorda à contrecœur, ce dont mon précepteur feignit de ne pas s’apercevoir.
Cela m’octroyait une nuit de répit. Je glissai vers le sommeil en songeant à Maria. Elle m’aimait ! Avais-je mérité cette chance ? Moi, empoté, elle, la grâce incarnée. Lui avais-je adressé dix paroles depuis que je la connaissais ? Et encore, des banalités ou, pire, des incongruités quand j’essayais de me rendre aimable et ne réussissais qu’à me ridiculiser. Et pourtant, elle m’aimait. Elle m’attendrait. Cette idée était bien douce. Cependant, cette nuit-là ce furent les bras ronds et la poitrine rebondie de Katel qui hantèrent des rêves rien moins qu’innocents. Saint Augustin avait bien raison d’absoudre ses visions nocturnes !
J’en voulus un peu à l’abbé de me ramener à la réalité au lever du jour. Les laudes expédiées, nous reprîmes le chemin de la cité.
Sitôt la porte passée, je m’amusai de la mine scandalisée du bon prêtre devant les désordres de la ville. Malgré l’heure matinale, rires et chansons fusaient par les fenêtres des estaminets où marins et soldats de la flotte dépensaient leur maigre solde en boissons et en plaisirs vénaux. Nombre d’entre eux, déjà ivres malgré l’heure matinale, tanguaient dans les rues boueuses. Ainsi que je l’appris plus tard, le jour où le brave abbé assista à ce spectacle qu’il trouvait affligeant, ces hommes revenaient des côtes d’Angleterre. La dysenterie, puis la tempête avaient mis un terme au projet de débarquement de nos troupes en Grande-Bretagne, que les Anglais, trop occupés par le soulèvement de leurs colonies américaines, eussent été bien en peine d’empêcher. Les soldats ne se souciaient guère de la déception de leurs officiers ni du coup que la Providence portait au très catholique royaume de France au profit de ces mécréants d’anglicans, qui pourtant ne respectaient pas le pape. Ils revenaient vivants de cette campagne avortée et entendaient s’en administrer à eux-mêmes la preuve en profitant des plaisirs de leur séjour terrestre.
J’enviais leur insouciance. J’étais loin de la partager. Ce ne fut pas sans un serrement de cœur que je franchis le seuil de l’hôtel de Rivelen. Le maigre abbé me paraissait un piètre bouclier. Il se révéla néanmoins efficace, puisque mon oncle, après m’avoir tout juste effleuré du regard, s’adressa à lui avec la courtoisie due à son état.
« Je vous remercie, mon Père, de m’avoir ramené ce jeune écervelé dont les manières me semblent encore très bourrues. » Se tournant vers moi, il demanda d’une voix égale : « Au moins, avez-vous pris soin de mon cheval ? »
Le rouge me monta au front. Je lui dis qu’on l’avait emmené aux écuries et qu’il était en bonne santé, vaguement vexé de constater qu’il s’inquiétait d’abord de son alezan. Cette nouvelle parut lui procurer une grande satisfaction.
« Il est un peu bouillant, plaida le P. Milon, reprenant la conversation où elle s’était interrompue avant cet intermède. Mais cela augure de sa vaillance. Comme l’écrit Homère : “Ainsi jusqu’à l’éther s’élève la lueur du bouclier d’Achille”… »
— Certes, certes », maugréa M. Combray, plus impressionné par la soutane du prêtre que par le lyrisme de l’aède.
Le voyant aussi conciliant, mon précepteur estima possible de tenir la promesse qu’il m’avait faite.
« Il aurait dû vous prévenir. Mais ses intentions n’étaient pas malicieuses. Il souhaitait seulement récupérer quelques documents personnels que, dans l’émotion du départ, il avait omis d’emporter. »
M. Combray ne sourcillait pas. Il offrait même un visage affable à l’abbé. Celui-ci s’absorba soudain dans la contemplation de ses mains jointes et ajouta, sur un ton détaché :
« Il souhaitait aussi me parler de l’état ecclésiastique où vous songez… »
Mon oncle leva la main pour prévenir toute argutie.
« Ne me dites pas, mon Père, que vous jugez ce projet déplacé. Je m’en suis entretenu avec le chantre de la cathédrale de Tréguier, qui honore ma table quatre fois l’an. Il trouve l’idée pertinente. La prêtrise convient aux gentilshommes sans fortune qui n’ont pas de charge dans l’armée. Sans doute le chantre en a-t-il déjà touché un mot à Monseigneur. »
Bien que prononcée d’un ton détaché, l’invocation de ces autorités exprimait une menace claire : un petit curé de campagne issu de la roture, même si par extraordinaire il pouvait se targuer de quelque instruction, n’était pas de taille à contrecarrer ses desseins. J’intervins avant que le P. Milon ne se mît dans un mauvais cas.
« Eh bien, soit, mon oncle. Je me conformerai à votre souhait. »
Mon précepteur me jeta de biais un regard qui disait assez ce qu’il pensait de ma docilité, mais il ne me trahit pas. Simplement, en m’embrassant avant de me quitter, il me souffla :
« Bonne chance, mon garçon. Montre-toi habile, et surtout patient. Souviens-toi que ce n’est pas la fougue d’Achille qui fit tomber Troie, mais l’astuce d’Ulysse.
— Je suivrai le dieu.
— Mais seulement pour ce qui ne dépend pas de ta volonté, n’est-ce pas ? »
Je me contentai d’un sourire.
« Bonne chance, répéta-t-il. Je prierai pour toi chaque jour. »
M. Combray le pria à dîner. L’abbé argua qu’il s’était déjà trop attardé loin de ses ouailles. Mon oncle n’insista pas. Mon protecteur parti, je m’attendais à ce que M. Combray laisse libre cours à son humeur et m’apprêtai à essuyer ses reproches. Il ne m’en adressa aucun, pas plus qu’il ne s’était donné la peine de lancer des recherches en apprenant mon départ. Je compris qu’il ne m’aurait pas tenu rigueur de disparaître, comme l’avait fait mon frère.
Plus méfiante, ma tante, informée du motif de ma fugue en même temps que de mon retour, voulut savoir quels documents je tenais tant à reprendre. L’avouer risquait de dévoiler mes plans. Aussi me gardai-je bien de lui montrer les lettres. Je lui tendis le livre que j’avais rapporté. Elle le considéra avec un dégoût horrifié.
« Moi vivante, jamais un ouvrage de ce diable qui reniait Dieu et osa chicaner la Sainte Église ne restera sous mon toit. »
Joignant le geste à la parole, elle jeta le volume par la fenêtre ouverte. Je serrai les dents, mais ne soufflai mot : j’avais préservé l’essentiel. Je demandai l’autorisation de prendre congé et me réfugiai dans ma chambre, pressé de lire les lettres de mon frère. Je n’avais pas osé le faire pendant le voyage, car je redoutais un sermon de l’abbé qui, devinant mon intention, aurait tenté de me dissuader. Je poussai le verrou. Juste au moment où je m’apprêtais à sortir la précieuse correspondance, on frappa à la porte.
Sur ma permission, Landry, un serviteur de ma tante, pénétra dans la pièce. Il me tendit un objet que je reconnus au premier coup d’œil. Le livre n’avait pas trop souffert de sa chute, sinon que la boue en avait maculé la reliure. Je m’en emparai, si interdit que je ne sus que bredouiller un remerciement bien trop timide au regard du service qu’il me rendait. Il sortit sans prononcer un mot. Pourquoi cet homme effacé avait-il couru le risque de défier sa maîtresse et perdre son emploi pour me restituer mon bien ? Je ne le sus jamais. Ce geste amical m’émut. Encore ne mesurai-je pas pleinement, ce jour-là, les conséquences heureuses de son acte.
Je repoussai la targette et exhumai la cassette de la couverture sous laquelle je l’avais dissimilée en hâte, par réflexe. Les lettres d’Yves commencèrent par m’exalter, avant de me décevoir. Elles évoquaient des contrées inconnues en des termes qui embrasaient mon imagination : Yves avait parcouru la côte d’Afrique, les Antilles, la Louisiane… Connaissant les lubies du marquis, il décrivait, avec une précision de naturaliste la végétation foisonnante de ces climats et donnait sur les mœurs des indigènes des détails tantôt amusants tantôt effroyables. Hélas, aucune de ces lettres ne portait de date, si bien qu’il m’était impossible de déterminer le dernier séjour de mon frère, ainsi que j’en avais caressé l’espoir. En outre, il se montrait fort discret sur sa propre existence, comme si, après avoir dressé le décor, l’acteur préférait fuir la scène. Tout juste consentait-il à de brèves indications sur sa santé. Encore était-ce toujours pour se plaindre du coût monstrueux des remèdes délivrés dans ces régions lointaines. Car ses lettres, je le discernai bientôt, visaient surtout à obtenir l’envoi de quelque argent. À plusieurs reprises, il promettait de s’amender et de revenir en Bretagne, pour peu qu’il réussisse à économiser le prix de la traversée. Mon père accédait-il à ses requêtes ? Malgré leur brouille, j’imaginais mal le marquis rester sourd aux supplications d’un fils repentant. Mais sans doute les intermédiaires chargés par Yves de convoyer la somme ne brillaient-ils pas par l’honnêteté. Car il réitérait la même demande de missive en missive et jamais ne délivrait quittance.
Un bruit dans le corridor m’alarma. Je dissimulai les lettres sous mon matelas. Les pas s’éloignèrent : probablement Landry qui, son service terminé, gagnait son logis sous les combles. Je soufflai ma chandelle. Mais je restai longtemps à rêver les yeux ouverts de rivages baignés par des océans lointains.
Le lendemain, le tailleur vint prendre mes mesures. Deux jours plus tard, un commis m’apporta trois habits, l’un de drap gris, l’autre de velours bleu, le troisième de soie grège, ainsi que des culottes et des gilets brodés. Jamais je n’avais revêtu de tenues aussi précieuses. Aucune circonstance, à Kervadec, ne les aurait exigées. Je les enfilai tour à tour avec une joie naïve, bien que, peu habitué à des vêtements aussi ajustés, je m’y sentisse engoncé. Quand j’apparus au dîner, vêtu de bleu, la mine de mes parents s’allongea. Je devinai sans peine leurs pensées. Ma tante se disait que la mise ne suffisait pas à masquer la grossièreté de mes manières. Son époux songeait au prix de l’étoffe.
L’après-midi même, Louise de Rivelen me fit appeler.
Elle tenait salon tous les mardis. À défaut d’attirer dans ce cénacle quelques officiers de haut rang qui, habitués aux cercles parisiens, eussent consacré sa gloire, elle se contentait d’une poignée de petits-maîtres se piquant de poésie et de deux ou trois jeunes abbés portant dentelles.
À mon entrée, un grand silence tomba sur l’assemblée, au centre de laquelle trônait Louise Combray de Rivelen. Délaissant sa tenue de deuil, elle avait revêtu une robe claire. Seule femme parmi ces hommes qu’on devinait assidus, elle laissait s’exprimer un charme auquel je n’avais pas jusqu’à présent rendu justice. Sur sa demande, j’avais enfilé l’habit de soie et m’étais coiffé d’une perruque poudrée, la première que j’eusse jamais portée. Je n’osais bouger la tête de crainte de la voir glisser, ni faire de grands pas, de peur d’entendre craquer les coutures de ma culotte.
« Mon neveu, Jean Hoel de Kervadec », me présenta-t-elle. Elle faisait sonner chaque syllabe comme un étendard fouetté par le vent. Une manière, pour elle, de rappeler le nom que lui avaient légué ses ancêtres. Cloué par le regard de dix inquisiteurs, je saluai la compagnie d’une voix indécise.
« Mais il parle le français ! s’écria un freluquet, gloussant de sa propre plaisanterie.
— Ajoutez-y le latin et le grec, répliquai-je. Mais croyez, Monsieur, que je préférerais n’entendre que le breton, si cela m’épargnait de subir la pédanterie d’un sot ! » Sans attendre d’être invité à prendre congé, je tournai les talons. J’étais très fier de cette repartie qui m’était venue spontanément.
Bien sûr, mon insolence ne pouvait rester sans suite. À son retour, M. Combray me convoqua.
« Que m’apprend-on, Monsieur ? Vous avez insulté les amis de mon épouse », gronda-t-il.
Il tourna la tête vers ma tante. Elle avait remisé la toilette de l’après-midi et redonné à sa coiffure une sévérité bourgeoise. Elle se tenait raide, les lèvres pincées, le front buté, telle une allégorie de la dignité outragée.
« Me croirez-vous, si je vous dis avoir répondu à un affront ? » plaidai-je.
Ma tante exprima par sa mimique l’indignation que lui inspirait mon audace. M. Combray, au contraire, paraissait assez porté à me croire. Néanmoins, il dit, d’un ton conciliant :
« Un affront, comme vous y allez ! Je crains, Monsieur, que vous n’ayez mal interprété une simple badinerie. Vous n’êtes pas habitué au monde…
— Assez pour savoir moucher qui me cherche des pouilles !
— Constatez par vous-même ! s’écria ma tante. Ce jeune coq monte sur ses ergots sitôt qu’on lui adresse la parole.
— Les Pères y mettront bon ordre, la calma M. Combray. Je m’occuperai dès demain de son admission au séminaire. »
Le conseil du P. Milon me revint en mémoire à point pour m’éviter un nouvel écart et me porter à la ruse.
« Mon oncle, je sais qu’en me confiant à l’Église vous n’avez d’autre considération que mon intérêt. Cependant, je respecte trop la religion pour prétendre à la barrette. Ma tante a raison : je suis irréfléchi, vindicatif, emporté. Sont-ce là les qualités qu’on attend d’un recteur ? En revanche, ce que vous m’avez laissé entrevoir de votre négoce excite ma curiosité. Mon oncle, ne pouvez-vous plutôt m’initier à votre état ?
— Ah çà ! s’insurgea ma tante. Oubliez-vous le nom que vous portez ? »
M. Combray blêmit.
« Dois-je vous rappeler, Madame, la cingla-t-il, qu’un noble ne déroge pas à exercer le commerce maritime ? Lequel, soit dit en passant, paie vos toilettes et vos fantaisies, voire les excentricités de vos amis, dont je me suis laissé dire qu’ils ne se font pas vergogne d’abuser de votre gentillesse ! »
Puis, se tournant vers moi :
« Quant à vous, Monsieur, il suffit. Mais ne vous croyez pas quitte. Nous en reparlerons. En attendant, regagnez votre appartement et ne vous avisez plus de troubler la sérénité de cette maison ! »
De ce jour, j’évitai la compagnie de ma tante. Sans trop de peine, car elle affectait une indifférence qui masquait mal son animosité envers moi. À ma propre surprise, je m’entendais mieux avec son bourgeois de mari. L’intérêt que j’avais manifesté pour sa profession avait radicalement modifié ses dispositions à mon égard. Certes, il avait réagi à la remarque désobligeante envers lui de son épouse. Mais son attitude ne s’expliquait pas seulement par cette circonstance. Ainsi que je l’avais bien compris dès mon arrivée à Brest, il n’avait d’autre raison de vivre que ce métier qui l’accaparait à toute heure du jour et de la nuit. Ses commis ne l’aimaient pas. Il ne se montrait pourtant envers eux ni méchant, ni pingre. Cependant il ne manifestait pas davantage de bonté, voire d’attention. À ses yeux, l’écriture sur le registre comptait davantage que la main qui la traçait. Il ne goûtait pas d’autre poésie que les chiffres. Il ne connaissait le vaste océan que par le décompte des jours nécessaires à ses voiliers pour acheminer leur cargaison. Il n’avait jamais embarqué sur l’un de ceux qu’il armait, fût-ce pour traverser la rade. Cela ne l’empêchait pas d’en connaître les moindres recoins. Il savait, à la livre près, quelles marchandises contenait leur coque pansue. Il n’aimait pas la guerre, qui gênait le commerce maritime, mais rêvait qu’on exterminât les Anglais jusqu’au dernier, parce que ces gens ne respectaient rien, ni le pape, ni le négoce français.
Mon stratagème réussit. Dès le lendemain de mon éclat, le tailleur m’apporta un habit plus modeste que les précédents, une redingote brune et un tricorne noir. Ainsi vêtu, je ne me distinguais pas des commis de mon oncle. Chaque matin, levé avant l’aube, M. Combray assistait à la messe. Puis je l’accompagnai jusqu’à l’office. Sur le trajet, il ne me parlait pas de séminaire, mais d’escomptes, de tonneaux de jauge et de routes maritimes. Je n’irai pas jusqu’à dire qu’il se montrait chaleureux. Mais au moins ne me manifestait-il plus le dédain qu’il m’avait opposé à nos premières rencontres. Du reste, le visage compassé qu’il affichait à l’hôtel du Champ de Bataille s’animait-il à mesure que nous approchions de ses bureaux du quai marchand. Monsieur de Rivelen était un rôle, Combray sa véritable nature.
Je passai les semaines suivantes à reporter des chiffres sur un registre, à l’instar des autres copistes. Ceux-ci connaissaient le lien de parenté qui me liait au négociant qui les employait. Méfiants, ils me battaient froid. Pourtant, mon seul privilège était de recevoir, la journée achevée, des éclaircissements sur l’origine et le contenu des mouvements que j’avais retranscrits. M. Combray se prenait au jeu. Il mettait à me dispenser ses leçons un zèle et une chaleur qui ne laissaient de me surprendre. Je feignis d’abord de me passionner pour ses affaires pour l’amadouer, mais je finis par trouver de l’intérêt à ses explications. Pas au point d’envisager d’embrasser son état, mais cela, je le cachai.
Au motif de contrôler le chargement des navires dont mon oncle m’entretenait en épluchant ses livres, je lui arrachai l’autorisation de m’aventurer sur les quais, ma journée achevée. De là, je me permettais des incursions dans les rues de Brest. M. Combray n’était sans doute pas dupe. Néanmoins, il ne contrariait pas ces escapades. J’avais en effet donné ma parole de gentilhomme de ne pas en profiter pour m’enfuir derechef. Malgré les mises en garde de ma tante, ce serment lui suffisait. Je me serais d’ailleurs plutôt laissé enfermer au bagne que d’y manquer.
Ce bagne, précisément, dominait de sa sombre masse la rive gauche de la Penfeld. On ne pouvait d’autant moins l’oublier qu’on rencontrait partout les forçats, aisément reconnaissables à leur casaque rouge et à leur pantalon jaune. Ils travaillaient à la voirie, au charroi du fret, au grattage des coques dans les bassins de radoub. C’étaient eux qui tournaient dans les cages d’écureuil pour actionner les grues, eux encore qui, à six ou huit, pesaient sur les manivelles des machines à fabriquer les cordages. Presque aussi nombreux étaient les soldats qui, en attente d’embarquement, encombraient les venelles étroites semées de cabarets plus ou moins louches. Ajoutons à cela les ouvriers et les tâcherons, les artisans et les matelots et l’on aura une idée du grouillement qui animait Brest en ce temps-là.
J’admirais les riches demeures de la rue de Siam, les échoppes de la Grande Rue. Je me perdais dans les ruelles escarpées, coupées d’escaliers, traînais vers les bassins de radoub. Il m’arrivait de m’engager dans le haut de la rue des Sept-Saints qui, malgré son nom, accueillait la plus grande dépravation. J’y venais en curieux. Je n’ignorais pas à quoi les sirènes qui frayaient dans ces eaux cherchaient à m’entraîner. Par jeu, Katel Le Bihan m’avait laissé voir le secret qu’une Bretonne dissimule sous son jupon, avant de m’initier à l’usage qu’un garçon peut en faire. Mais, les préceptes que m’avaient inculqués et mon père et mon maître m’inspiraient de l’aversion pour ce commerce. La faute, à mes yeux, aurait été moins de succomber à la luxure que d’acheter le corps d’une fille. Et puis aucune de ces ribaudes n’avait la vigoureuse fraîcheur de la Katel, et encore moins la beauté solaire de Maria ; c’eût été porter injure à l’une comme à l’autre que répondre à leurs appels. Au demeurant, je n’avais pas un liard en poche, ce qui m’aida beaucoup à persévérer dans des dispositions vertueuses. Je me liai avec un passeur, qui consentait quelquefois à me prendre en surnombre dans son bac pour me déposer sur l’autre rive de la Penfeld. Tout un peuple d’artisans et d’ouvriers se pressait à Recouvrance, à l’ombre de l’église Saint-Sauveur. Dans ce faubourg où on se logeait à moindre coût, on ne voyait guère de messieurs en habits, comme dans la paroisse Saint-Louis. On y parlait peu le français, beaucoup le breton, mais aussi bien d’autres jargons, car l’arsenal attirait de la main-d’œuvre venue de tout le royaume.
Au début d’octobre, la température fraîchit. Un crachin obstiné s’installa. Mais ni la pluie, ni la froidure qui empirait de jour en jour, prémices selon les commis de mon oncle d’un hiver particulièrement rigoureux, ne me dissuadaient de courir les rues. L’agitation de la foule ne m’étourdissait plus. Je m’y plaisais au contraire. Elle me distrayait de l’atmosphère compassée de l’hôtel de Rivelen et de l’ambiance studieuse du négoce Combray.
Le nombre des soldats présents dans la ville croissait. Bientôt le bruit courut que le comte d’Hector, le commandant de l’arsenal, avait reçu mission de préparer la flotte à appareiller avant le printemps.
Cinquante vaisseaux à radouber ! Deux mois de vivres à engranger dans les soutes ! Dans un temps aussi court ! Chacun s’accordait à juger la tâche impossible. Toute la ville, cependant, s’y consacra. À l’arsenal, on travaillait même la nuit, à la lueur des torches et des chandelles. Mon oncle houspillait ses gens : un convoi marchand profiterait de la traversée de la flotte pour gagner les Antilles sans courir le risque d’une attaque anglaise. Il voulait que ses navires en soient. Et moi, chaque fois que mon emploi à l’office me le permettait, je me jetais dans ce tourbillon comme dans une fête.
Toujours mes pas me ramenaient au port. Non loin du château qui en protégeait le débouché, la machine à mâter me fascinait par ses dimensions. À l’abri de bâches immenses, les bâtiments à l’amarre s’alignaient sur deux, voire trois rangs, de chaque côté de la Penfeld, refoulant les navires marchands vers l’aval, au grand dam de M. Combray. Leurs gréements démontés encombraient le quai. Quant à ceux qu’on armait, je ne me lassais pas d’admirer leur race, leur proue arrogante, le luxe avec lequel les sculpteurs avaient orné leur poupe. Avec leur étrave puissante, leur taille-mer effilé, leurs préceintes vigoureuses, ils me semblaient indestructibles : je ne connaissais pas encore la puissance de l’océan.
Un soir, à proximité du bassin de radoub, le manège louche de trois individus retint mon attention. La main fermée sur un de ces crochets acérés dont usent les portefaix pour soulever les ballots, ils se dissimulaient derrière un empilement de vieilles barriques qui achevaient de pourrir sur le quai. Le chef de la bande affichait un sourire démoniaque. Du moins je le crus tout d’abord. Mais, intrigué par son masque figé dans une expression aussi affreuse, je l’observai plus attentivement : ce que j’avais pris pour un rictus était en fait une cicatrice qui, partant de la commissure des lèvres, courait jusqu’à sa pommette.
Il avança la tête, la rentra précipitamment, glissa quelques mots à voix basse à ses comparses. Un marin de haute taille approchait, le pas rendu hésitant par l’ivresse. Je ne le connaissais pas, mais la lâcheté de ce guet-apens me révolta. En silence, j’escaladai la futaille de façon à dominer l’embuscade. Comme l’homme arrivait à quelques pas, je poussai du pied le tonneau du sommet. Entraînés par son mouvement, la pyramide s’écroula, me laissant tout juste le temps de sauter à terre. Mon stratagème avait produit l’effet que j’en attendais. Menacés par la chute des barriques, les trois gredins quittèrent leur cachette. Contrairement à mon attente, leur victime désignée ne détala pas en les voyant. Avec un rugissement de bête fauve, il se précipita sur eux, le poignard à la main. Bien que supérieurs en nombre, les malandrins s’enfuirent sans oser engager le combat. L’homme salua cette débandade par un énorme éclat de rire et de grands moulinets de son arme.
Le temps de me relever, tout était fini.
« Foi de Papegai, mon gaillard, beugla-t-il, tu as joué un fameux tour à ces forbans. »
Il me donna l’accolade, me serrant à m’étouffer. Il sentait la sueur et la vinasse.
« Allons fêter ça ! »
J’essayai de décliner l’invitation, mais son visage prit une expression terrible et sa main se crispa sur le manche de son poignard : mon obligé avait le vin susceptible ! Je me laissai donc entraîner dans une sombre gargote, où l’on me servit la piquette la plus aigre qu’il m’ait été donné de boire.
Là, mon hôte m’apprit que j’avais l’honneur de partager la table d’un gabier. Chacun savait que les matelots chargés de manœuvrer la voilure constituaient l’élite de l’équipage. Et comme il ne faisait aucun doute que, de toutes les corporations, celle des marins était la plus digne de considération, il devenait évident que j’avais affaire au modèle le plus accompli de l’humanité. Cela se mesurait d’ailleurs à la témérité avec laquelle il vidait le pichet, supportant sans broncher l’acidité du breuvage.
Il entreprit ensuite de me raconter ses campagnes. Il avait participé à la bataille qui avait opposé la flotte du Ponant aux vaisseaux anglais au large d’Ouessant. Je ne tardai donc pas à apprendre que les Français devaient leur victoire moins à la science maritime de l’amiral d’Orvilliers qu’au courage, au sang-froid et à la maîtrise d’un matelot surnommé Papegai.
« C’était en juillet 78. Depuis dix jours, on essuyait grain sur grain. Ça finit par beausir et qu’est-ce qu’on voit ? Les voiles anglaises… ». Trois jours de poursuites et de dérobades, puis un combat qui, débuté à la mi-journée, se prolongea jusqu’à la nuit : le récit dura trois pichets.
« En somme, avançai-je pour lui être agréable, rien ne vaut la vie de marin. Tu dois être impatient de reprendre le large. »
Il écrasa son poing sur la table, en proie à une furieuse indignation.
« Plus souvent qu’on verra Papegai sur un vaisseau du roi ! J’ai mon congé, Dieu merci ! Monter à bord d’un de ces enfers flottants, c’est s’embarquer pour la mort. Et encore, la mort, c’est une douceur qui met fin à tes souffrances. Tiens, j’aime encore mieux coiffer le béret rouge ! Un bagnard dans les chaînes est plus heureux qu’un marin. Si tu me vois la tête un peu chaude, ce soir, moi qui d’ordinaire suis sobre comme le saint Jean qui baptisa le Christ, c’est que je fête mon retour à la vie ! »
Il démontra son propos par des exemples plus effroyables les uns que les autres, où les punitions succédaient au scorbut et à la dysenterie, la faim et la soif à l’horreur des combats. La nuit était tombée. Il fallut que la cloche de Saint-Louis commençât à sonner le couvre-feu pour que Papegai consentît enfin à quitter cette salle qu’enfumaient les pipes de matelots braillards.
Je m’échappai en courant. Malgré l’obligation faite aux occupants des rez-de-chaussée de maintenir une chandelle allumée à leur fenêtre, les ruelles étaient obscures et je craignais de m’égarer. Je ne disposais que d’un quart d’heure pour rejoindre l’hôtel de Rivelen. C’est avec soulagement que je remontai la Grande Rue où les tenanciers fermaient boutique.
Je me glissai discrètement dans la maison et gagnai aussitôt ma chambre. Le lendemain, M. Combray ne m’adressa aucun reproche au sujet de mon absence au souper. Au contraire, quand ma tante m’en fit la remarque, il me trouva une excuse. Quelque surprise que me procurât cette indulgence, je l’interprétai comme une permission. Cette première équipée nocturne ne fut donc pas la dernière. À plusieurs reprises, je retrouvai Papegai, qui n’en finissait pas de fêter son congé. Quand il était ivre, il poursuivait le récit de ses exploits. Lorsqu’il n’avait pas bu, il parlait du bonheur que connaîtraient les hommes si, à bord des navires, il n’y avait pas d’officiers et, à terre, pas de noblesse ni de clergé pour sucer le sang du peuple. Cela m’amusait de l’entendre pérorer contre les aristocrates sans qu’il soupçonne mon origine, même si quelquefois l’outrance de ses propos m’inquiétait un peu. Dans les tavernes où le vin déliait les langues, j’apprenais à connaître les hommes autrement que par les livres.
Je menais cette existence de badaud depuis presque trois mois, quand un soir, à la fin du repas, mon oncle se tourna vers moi et dit, sur un ton glacial :
« On m’a rapporté sur vous des bruits étranges. »
Le sourire contraint de ma tante m’alarma.
« Quels bruits ? demandai-je, la voix blanche.
— Vous avez abusé de la permission que je vous ai donnée. Vous fréquentez des lieux bien peu recommandables.
— Je vous proteste, mon oncle, que…
— N’ajoutez pas le mensonge au nombre de vos turpitudes. J’ai des informateurs dans tout le port. Vous êtes mon neveu. Certains voyaient déjà en vous mon successeur, puisque Dieu ne m’a pas donné d’héritier. Je ne saurais tolérer que vous ternissiez la réputation de mon négoce par votre dissipation. Fréquenter les cabarets et se complaire dans la compagnie d’ivrognes poissards ! A-t-on idée ! Dès demain, vous prendrez le chemin du séminaire ! »
La sentence m’assomma. J’avais presque oublié cette menace. M’avait-il laissé la bride sur le cou pour endormir ma méfiance, me piéger et revenir à son intention première sans perdre la face ? Les larmes me montèrent aux yeux, et je me cabrai pour conserver toute ma dignité en présence de ma tante, qui ne m’épargnait pas son triomphe.
Cette nuit-là, je dormis peu. Je retrouvai intact mon ressentiment envers M. Combray, découvrant du même coup, à ma surprise, que ses attentions envers moi l’avaient un peu émoussé. Et je retrouvai toute ma vindicte. Je ne savais pas encore de quelle manière, mais ma connaissance des affaires de M. Combray serait un jour une arme au service de ma vengeance !
Quand les étoiles, au-dessus des toits, pâlirent, j’envisageai la situation avec plus de sang-froid. Puisque M. Combray avait rompu le pacte que nous avions passé, je ne me sentais plus tenu par mon serment de ne pas m’enfuir. Or, la conversation de Papegai avait confirmé ce que l’agitation du port et la rumeur publique m’avaient appris : on armait la flotte pour lutter contre les Anglais en Amérique. L’Amérique ! Ma chance de retrouver Yves, de le ramener, de confondre les coquins…
À l’aube, je rassemblai dans un sac de toile mon maigre bagage et me glissai hors de la maison.
***
RDV vendredi prochain pour le dernier épisode !
Les éditions Argyll
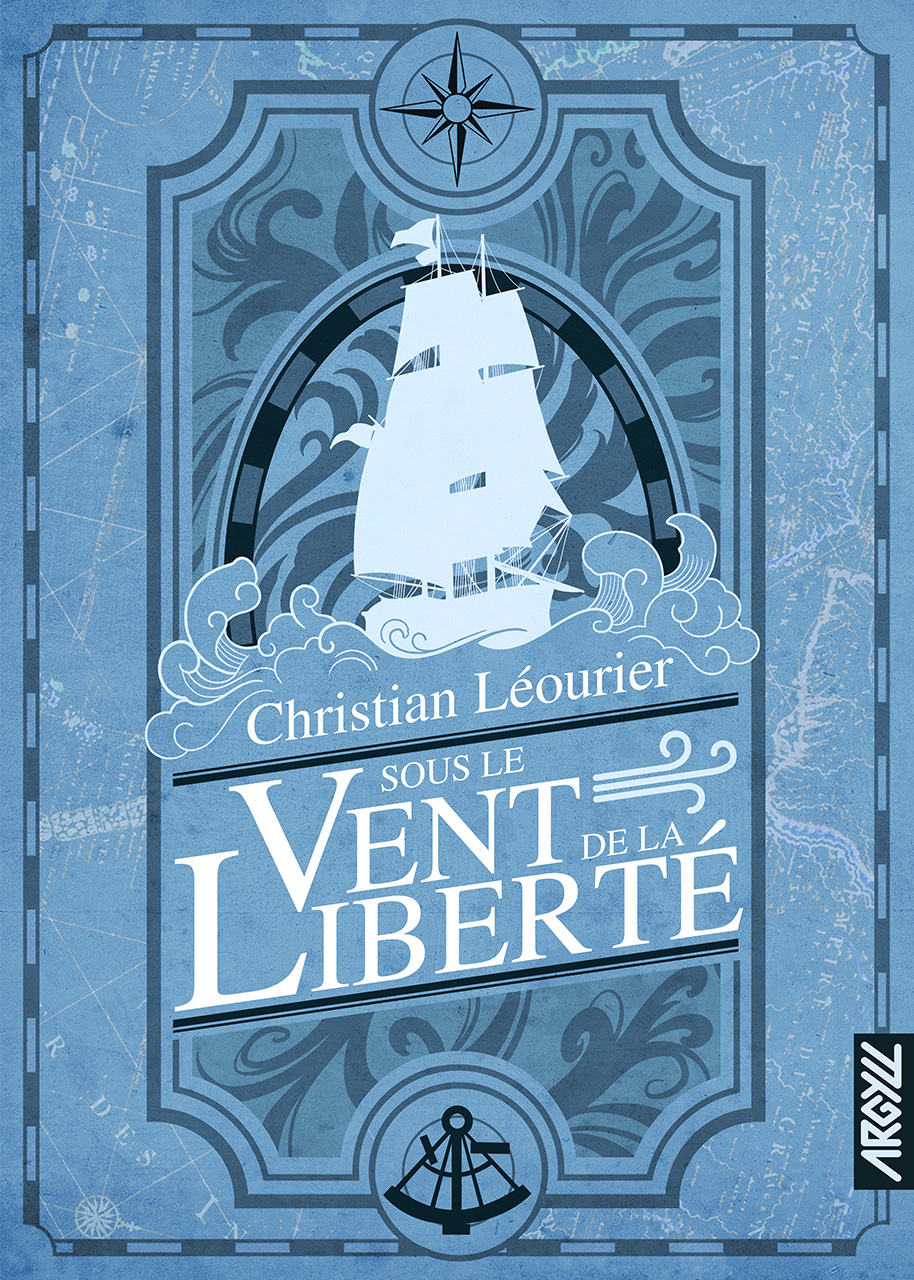 ">
">